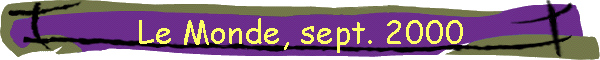Le
Kosovo
Par David Murray
Une couverture médiatique exemplaire?
Il y a maintenant près de un an et demi, le 24 mars 1999, s’amorçait
le bombardement aérien de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord
(OTAN) contre la République fédérale yougoslave (RFY). Suivi au pas par les médias
occidentaux, la guerre du Kosovo fut le conflit international dont la couverture
médiatique fut la plus importante depuis la guerre du Golfe. Ayant en souvenir
le faux charnier de Timisoara et les bévues du conflit irakien, ceux-ci se félicitèrent
de leur exemplaire couverture de la campagne aérienne. Il en est à se
demander, toutefois, si tel en fut effectivement le cas.
Avec le recul et à la lumière de plusieurs travaux d’intellectuels,
journalistes et organisations internationales, il semble bel et bien que non.
Malgré s’être vanté de garder constamment un œil critique sur
l’information et les images obtenues, l’essentiel des médias occidentaux
– mise à part une poignée de journalistes et intellectuels dissidents –
furent complètement soumis aux dires de l’OTAN et n’affichèrent
pratiquement jamais le souci de remise en question. Dès que l’OTAN entreprit
ses frappes aériennes contre la RFY, sous la bannière d’un « bombardement
humanitaire » afin de sauver les Albanais du Kosovo d’un génocide, la
presse approuva cette intervention et moussa le concept de « guerre morale ».
Ceci se fit sans même s’assurer de la légitimité de l’OTAN à mener une
telle guerre. Ne cherchant pas non plus à comprendre la logique de celle-ci, la
presse occidentale se confina aveuglément dans la conviction qu’il fallait
venir en aide aux Kosovars albanais et ce, sans même savoir si ceux-ci étaient
réellement victimes d’un génocide. Qu’en était-il donc de cette guerre ?
Une guerre inéluctable… (pour L’OTAN)
Contrairement à ce qui fut présenté comme un dernier recours afin de
faire plier le président yougoslave Slobodan Milosevic aux volontés des
Occidentaux, le bombardement de l’OTAN fut une option envisagée à
l’avance. Le retrait du Kosovo des observateurs de l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE), une semaine avant les bombardements, venait
confirmer le choix de cette alternative. Cependant, il fallait trouver un prétexte
pour entériner cette décision. Pour l’OTAN, celui-ci devait se traduire par
le refus serbe de signer l’accord de Rambouillet, présenté par les médias
comme « l’unique » accord de paix possible. Le refus eut
effectivement lieu.
Toutefois, il aurait pu en être autrement. Comme l’a notamment démontré
Noam Chomsky, les options diplomatiques ne furent pas toutes envisagées et la
guerre aurait pu être évitée. Par exemple, la résolution de l’Assemblée
nationale serbe – qui resta cachée au public – qui dénonçait le retrait
des observateurs de l’OSCE et qui favorisait un règlement diplomatique de la
question kosovare, ne fut pas prise en considération par les négociateurs
occidentaux. Pour ce qui est de l’accord de Rambouillet, les dernières
dispositions insérées dans celui-ci – elles aussi cachées au public – après
que les Serbes en eurent acceptés les principales dispositions politiques,
rendaient le refus serbe inéluctable. En effet, la fameuse Annexe B accordait
à l’OTAN « le droit de passage libre et sans restriction et un accès
sans ambages dans toute la RFY, y compris l’espace aérien et les eaux
territoriales associés » (Le Monde diplomatique, mars 2000). Une mesure
qui sapait toute souveraineté yougoslave sur son territoire et donc
inacceptable. Le refus serbe en poche, le prétexte pour lancer les
bombardements était maintenant acquis. Restait à trouver un mobile de guerre
pour le grand public afin de légitimer celle-ci.
La logique de la guerre du Kosovo présentée au public se fit donc sous
l’étendard d’un secours aux populations albanaises en péril. Sur ce point,
la passivité des médias fut exemplaire, aucun ne cherchant véritablement à
confirmer le génocide ou à contredire les chiffres avancés par l’OTAN
concernant celui-ci. Malgré le fait que le régime de Belgrade avait été
coupable de nombreuses atrocités par le passé – que l’on pense au massacre
de Srebrenica, en 1995 – rien ne garantissait qu’il en était de même pour
le Kosovo. Plusieurs faits sont venus corroborer cette hypothèse. Comme le
notait l’économiste Michel Chossudovsky, il y avait notamment le fait que des
réfugiés albanais se dirigeaient vers la Serbie et Belgrade ! De plus, la
confidentialité du rapport de l’OSCE ainsi que les entreprises boiteuses des
dirigeants de l’OTAN de prouver la
préméditation du génocide – notamment le plan « fer à cheval »
- sont venus confirmer le peu de sérieux de celui-ci.
C’est cependant la diminution constante de l’ordre de grandeur du
nombre de victimes divulguées par les médias qui est venue confirmer l’idée
qu’il n’y eut pas de génocide. Au début du conflit, le nombre se situait
entre 100 000 et 500 000. Le 19 avril, le département d’État américain
annonçait en effet que « 500 000 Kosovars albanais sont manquants, et
l’on craint qu’ils n’aient été tués » (Le Monde diplomatique,
mars 2000). Une fois la guerre terminée, l’ordre de grandeur tombait dans les
cinq chiffres. Le 25 juin, notamment, « le président Clinton confirme le
chiffre de 10 000 Kosovars tués par les Serbes » (Le Monde diplomatique,
mars 2000). Désormais, ceux qui croient encore qu’il y eut génocide risquent
d’être déçus. En effet, le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY) n’a jusqu’à maintenant exhumé que 2108 cadavres,
pour la plupart retrouvés dans des tombes individuelles. Ces données
corroborent avec les observations faites par plusieurs organisations
internationales et journaux, dont le quotidien espagnol El Paìs, qui se sont
rendus au Kosovo afin d’y découvrir la présence de nombreux charniers, ce
qui ne fut pas le cas. Il s’avère donc que les victimes albanaises résultent
plus de la lutte opposant l’Armée de libération du Kosovo (UCK) aux forces
yougoslaves qu’à un massacre soigneusement préparé.
Pour ce qui est de la conduite de la guerre, plusieurs faits de grande
importance passèrent sous silence ou ne furent que brièvement abordés durant
les 78 jours que dura le bombardement. En premier lieu, il y a le fait que l’OTAN
déclencha ses opérations sans aucun mandat international, violant ainsi la
Charte des Nations unies. Ceux qui insistent pour que Slobodan Milosevic soit
traduit en justice, devraient aussi en faire de même pour les dirigeants
occidentaux. En effet, ces derniers ont violé plusieurs lois de la guerre
durant le conflit. Ils ont notamment enfreint le protocole 1 des conventions de
Genève de 1949 qui « interdit les attaques contre des personnes ou des
biens civils » (Le Monde diplomatique, juillet 2000). Il faut cependant
noter que dans le cas présent, les Etats-Unis, la France et la Turquie n’ont
pas signé ce protocole, témoignant de leur grand humanisme ! L’organisation
Human Rights Watch a quant à elle répertorié la mort d’environ 500 civils
yougoslaves due à pas moins de 90 incidents du genre, parmi lesquels figurent
le bombardement des quartiers généraux et des studios de la Radio-Télévision
serbe. On note aussi d’autres violations du droit international comme
l’utilisation de bombe à uranium appauvri. Finalement, pour ce qui est du
traitement des bavures de l’OTAN,
la technique pour les atténuer fut simple, comme l’avoua un général de l’OTAN :
« Pour les bavures, nous avions une tactique assez efficace. Le plus
souvent, nous connaissions les causes et les conséquences exactes de ces
erreurs. Mais afin d’anesthésier les opinions, nous disions que nous menions
une enquête et nous révélions la vérité que quinze jours plus tard, quand
elle n’intéressait plus personne. L’opinion, ça se travaille comme le
reste » (Le Nouvel observateur, 1er juillet 1999).
Arrive maintenant les buts de la guerre. Voilà un domaine où les médias
furent totalement muets. En effet, qui sait quels furent les véritables enjeux
de cette guerre ? Pour résumer, cette intervention consistait pour l’OTAN (et
en premier lieu les États-Unis) à s’implanter solidement dans le Sud-est de
l’Europe et à maintenir au plus bas l’influence russe sur le vieux
continent, entreprise amorcée avec les Accords de Dayton, en 1995. Cette
intervention visait aussi du même coup à redéfinir le rôle de l’OTAN en
tant qu’alliance militaire. De plus, bien que la plupart des médias ont
considéré le Kosovo comme un espace négligeable, il ne l’est peut-être pas
autant qu’on le pense sur le plan économique. En effet, cette région
« recèle la plus grande concentration de richesses minérales dans
l’ensemble de l’Europe du Sud-est » (Le Monde diplomatique, décembre
1999). Sur le plan géographique, son intérêt est aussi loin d’être négligeable,
comme l’explique l’ancien ambassadeur des États-Unis pour l’OTAN :
« cette province constitue la porte d’entrée dans des régions d’intérêt
primordial pour les Occidentaux – le conflit arabo-israélien, l’Irak et
l’Iran, l’Afghanistan, la Caspienne et la Transcaucasie. La stabilité en
Europe du Sud est essentielle pour la protection des intérêts occidentaux et
la réduction des dangers venant de plus loin à l’Est » (HALIMI serge
et Dominique Vidal, L’opinion, ça se travaille…, Agone Éditeur, 2000, p.
12).
Cette guerre donc, loin d’être banale, tant par son contenu que par
son traitement, aura vraisemblablement des conséquences importantes sur la scène
internationale. Toutefois, les plus grandes leçons à en tirer pour nous,
simples citoyennes et citoyens, se trouvent dans la couverture médiatique qui
lui fut accordée. La guerre du Kosovo a, en effet, prouver une fois de plus à
quel point il faut savoir rester critique face aux informations qui nous sont
transmises et à quel point les médias se trouvent sous la botte des preneurs
de décision.
Haut de la page
Index - Le Monde