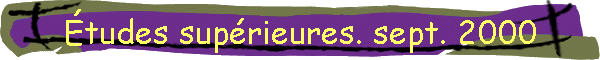Petite autobiographie d’un étudiant de maîtrise
Par Martin Gravel
Salut tout le monde !
Je commence présentement ma deuxième année de maîtrise en
histoire et M. Teasdale, rédacteur en chef du Sablier, nouvelle mouture que
vous avez entre les mains, m’a gentiment demandé d’écrire quelques lignes
sur mon projet de recherche et le cheminement de mes études. Je ne pense pas
que ma petite vie d’étudiant soit particulièrement originale, mais si j’ai
bien compris, l’objectif de cette série d’articles est de renseigner les
étudiants du premier cycle sur la vie après le bac. L’idée me semble
excellente. Pour ma part, j’aurais sans doute bien profité de ce genre d’information
en hiver 1999 lorsque je me suis retrouvé avec quelques semaines pour me
dénicher un directeur de maîtrise et un projet qui fut susceptible de m’amuser
pendant un "boutte"…
Haut médiéviste ? Pourquoi pas !
Je suis donc apprenti médiéviste et je m’intéresse tout
particulièrement à la première phase du Moyen Âge, celle qui a encore,
hélas, très mauvaise réputation : invasions barbares, effondrement de la
structure sociale romaine, chute du commerce, grande noirceur, fin du monde,
bla-bla-bla-bla-bla… Vous connaissez les clichés et j’en soupçonne
quelques-uns d’y adhérer encore. Honte à ceux-là! Je ne suis pas mandaté
par Le Sablier pour défendre le Haut Moyen Âge, je dirais simplement
que le haut médiéviste dispose en effet de beaucoup moins de sources écrites
que les historiens des périodes qui précèdent et qui suivent. Mais justement,
moi, ça m’amuse ! Essayer de comprendre 500 années d’histoire
européenne avec si peu représente un formidable défi, où l’intuition et l’imagination
sont à l’honneur. Les sciences auxiliaires de l’histoire, en particulier l’archéologie
et la philologie, contribuent à combler certaines lacunes documentaires
importantes. Avoir à consulter régulièrement les travaux de chercheurs
oeuvrant dans les autres branches des Sciences sociales est très amusant.
Bilan d’une première année aux cycles supérieurs
Mais à quoi ressemble donc mon travail dans tout ça ?
Disons d’abord que ma première année aux études supérieures a été
passablement alourdie par ma scolarité et un certain nombre d’engagements
parallèles comme auxiliaire d’enseignement, auxiliaire de recherche et
comme correcteur. Toutes ces activités s’avèrent très enrichissantes et
forment une des plus grosses différences avec la routine du premier cycle.
Même pour des tâches, somme toute modestes, c’est un réel plaisir d’avoir
la chance de travailler dans des situations où mes responsabilités dépassent
mes propres intérêts, plutôt que de "piocher" sur des travaux de
fin de session dont les succès ou les échecs ne touchent que moi. Mais être
en position d’être apprécié, implique aussi courir le risque de décevoir,
qu’il s’agisse de mes directeurs, de mes employeurs ou des élèves qui
comptent sur moi pour les corriger décemment et les aider à l’occasion. C’est
une grosse affaire, la maîtrise, mais combien stimulante ! À travers tout ça,
je suis quand même parvenu à lire suffisamment pour me familiariser avec ma
période, mon sujet et une partie de mes sources. Cet été, je me suis enfin
rapproché davantage de ma recherche en tant que telle, et ce, en peinant sur la
masse de documents latins que je dois aller consulter aux Collections spéciales
de la BLSH. Bref, l’année qui commence sera celle de la recherche à temps
plein, libérée des embêtements liés à la scolarité, mais avec en
parallèle, les différents engagements dont je viens de parler et dont je ne me
priverais pour rien au monde.
Mon sujet de recherche
En ce qui concerne mon projet de maîtrise, disons que je me
penche sur la correspondance des lettrés qui ont vécu alors que le monde
carolingien atteignait ses sommets culturels et politiques, ceux qui ont été
formés dans le cadre des programmes d’études établis par les premiers
artisans du rêve carolingien. J’espère éclairer la façon dont l’écrit
et l’oral étaient alors utilisés conjointement afin de communiquer à
distance. La question est importante, car aucun groupe social ne peut exister
sans moyens de relier entre elles ses différentes composantes sur l’ensemble
de son territoire. Qu’il s’agisse d’un empire ou d’une ligue de
balle-molle importe peu. Qui plus est, la façon dont une société met à
profit les moyens de communication à sa disposition colore, de façon
considérable, le tissu même de ladite société. Or, de l’Empire romain à l’Union
européenne, l’Europe n’a pas connu d’entité politique durable aussi
ambitieuse et d’une aussi grande étendue que l’Empire carolingien. À elle
seule, cette construction sociale de plus de 2 000 000 de kilomètres
carrés prouve qu’à la fin du VIIIe siècle en Europe de l’Ouest,
les outils nécessaires à l’élaboration d’une entité politique de grande
envergure étaient disponibles ou du moins envisageables et parmi ceux-ci l’écriture
et ses artisans figurent parmi les plus importants.
Ceci dit, à ce stade, j’ai dû en dégoûter plusieurs
avec mon Moyen Âge, mais je vous encourage à lire la suite, car heureusement
la problématique générale de ma recherche est susceptible d’intéresser
tout le monde, quelle que soit la période ou le domaine d’étude. C’est la
raison pour laquelle j’ai cru bon de vous en parler un peu pour finir.
Oralité et écriture : une passionnante problématique.
Dans l’ensemble, mon projet de maîtrise concerne l’invention,
le raffinement et l’assimilation progressive par l’homme de la technologie
la plus marquante de son histoire : l’écriture. De ses premiers
balbutiements, un gouffre de plus de 5 000 ans nous sépare, pendant lequel tous
les aspects de la vie humaine ont été graduellement bouleversés par l’utilisation
de ce nouvel outil, qu’il s’agisse de la pensée, de la religion, du droit,
du commerce, des arts et de toutes les autres facettes de l’organisation
sociale ou de la vie privée. Les schèmes courants de pensée de l’analphabète,
surtout celui qui évolue dans un milieu peu ou pas touché par l’écriture,
sont étonnamment différents des nôtres, universitaires juniors saturés par l’écrit.
Pas question de m’étendre là-dessus, mais pour plus de détails, je
recommande fortement la lecture du petit bouquin de l’anthropologue Walter
Ong, « Orality and Literacy : The Technologizing of the Word ».
C’est un livre amusant et facile, qui parvient cependant à couvrir l’essentiel
du sujet. Je paie une grosse "Molson" à quiconque se le tape et vient
me dire que ça n’a pas changé grand chose dans sa façon d’appréhender l’histoire
et l’expérience humaine en général.
Cela dit, il serait injuste de vanter l’impact déterminant
de l’écriture sans donner à l’oralité la place qui lui revient. Car l’être
humain est d’abord et avant tout, l’animal parlant. Le langage apparaît au
même moment que l’Homme, si bien que la propension à utiliser la parole pour
communiquer est littéralement inscrite dans nos gènes. On peut enlever l’écriture
à l’homme, mais le priver du langage le dénature complètement. Encore
aujourd’hui, l’oralité est à la base de notre mode de vie et de toute
façon, le langage que nous utilisons pour communiquer par écrit est fondé sur
l’oral. Qui plus est, l’oralité possède son efficacité propre, ses
modalités de fonctionnement, son génie. Des générations de chercheurs se
sont penchés sur l’Iliade et l’Odyssée, clamant qu’il y avait là les
plus grandes oeuvres littéraires qui soient. Arrivèrent un jour Milman Parry
et Albert Lord qui démontrèrent qu’il s’agissait essentiellement de
transcriptions d’œuvres orales partiellement improvisées ! Les
sociétés construites sur l’oral se passent de l’écrit sans aucun
problème et savent trouver ailleurs les moyens de suppléer aux limites de la
mémoire et à l’évanescence de la parole dite. L’homme «oral» ne quitte
jamais tout à fait l’homme «écrit», mais l’un et l’autre se
ressemblent si peu qu’on croirait observer deux créatures différentes.
Bon, ça suffit! Je me déçois un peu parce que je sens que
mes deux derniers paragraphes ne suffisent pas à rendre justice à l’importance
de la problématique de l’oral et de l’écrit. Je termine donc en vous
lançant moi-même deux ou trois questions : Quel niveau de complexité
pourraient atteindre les échanges commerciaux sans la liste, la table et les
autres outils que lui fournit l’écriture ? Que serait le Judaïsme si
son Dieu n’avait pas daigné écrire sa loi ? Comment aurions-nous
pu rejoindre la lune sans plans, sans systèmes de mesure fiables, sans
possibilité de consulter la masse de travaux et de résultats d’expérience
dont dépend une telle entreprise ? L’Histoire ne débute-elle pas avec
les premiers documents écrits ? L’historien qui ignore l’histoire de l’écriture
est semblable au menuisier qui ignore la nature du bois qu’il travaille. Ce n’est
peut-être pas si grave mais ça manque un peu de charme…
Voici donc en peu de mots ce en quoi consiste ma recherche et
quelles ont été mes expériences de "maîtrisant" jusqu’à date.
En espérant que vous puissiez trouver dans ce petit texte des réponses à vos
questions concernant la maîtrise ou peut-être des idées pour vos propres
travaux, je vous souhaite à tous et à toutes un bon début d’année.