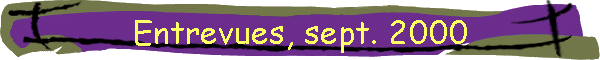
|
|
|
Histoire d'une femme :Denyse Baillargeon
Par Mélanie Chartrand (melhisto@hotmail.com) et Sonia Léger
Le 6 juillet dernier, nous avons eu la chance d'interviewer Denyse Baillargeon, professeur au département d'histoire de notre université. Ceux qui étaient présents à la rencontre des nouveaux étudiants, le 8 juin dernier, se rappelleront son " désir " d'être interviewée au même titre que nos célèbres personnalités. Nous l'avons donc prise au mot! Son accueil a été des plus chaleureux et sa participation, très dynamique. Il nous fait donc plaisir de vous présenter une femme qui mérite d'être mieux connue.
Son adolescence vécue dans les années 1960 lui a permis de connaître à la fois les cours classiques et le secondaire des polyvalentes. Après des études au CEGEP, elle débute de courtes études en droit. En effet, elle découvre après trois semaines que son rêve de défendre la veuve et l’orphelin n’est pas ce qu’elle imaginait. Elle s’est alors inscrite en histoire à l’Université de Montréal. Durant son baccalauréat, elle a la chance d’enseigner les sciences humaines au secondaire. Elle s’y découvre un intérêt pour l’enseignement et poursuit ses études tout en enseignant au CEGEP Maisonneuve et à l’UQAH. L’histoire ouvrière a été le sujet de ses recherches à la maîtrise. L’Université de Montréal s’est toujours imposée comme lieu d’étude et d’enseignement. C’était le seul endroit francophone à Montréal qui étudiait l’histoire des femmes, sujet de son doctorat. En effet, après sa maîtrise, l’histoire ouvrière ne suscite plus autant son intérêt. Le nombre croissant de travaux sur l’histoire des femmes dans les années 1980 attire cette féministe qui consacre sa carrière à ce sujet. Elle poursuit présentement ses recherches sur la maternité au Québec au XXe siècle. Elle tente de voir, à travers les services dispensés, la perception de la maternité avant l’arrivée de notre système de santé actuel et gratuit. Mme Baillargeon ne préfère aucun aspect de son métier. Selon elle, l’enseignement, la recherche et la rédaction constituent un équilibre et une diversité qui lui plaît. Cependant, son horaire est très chargé. Elle doit enseigner, corriger, faire des recherches, préparer ses cours, rédiger et corriger des articles, lire des thèses et des mémoires, participer à des réunions et accomplir plein d’autres tâches. Bref, il n’est pas rare que sa journée débute vers 8h30 et se termine vers 22h00. Même les week-ends ne sont pas des périodes de repos. Elle a donc une grande autodiscipline. En plus de toute cette charge de travail, elle est la responsable du comité de premier cycle du département. Sa fonction consiste à diriger le comité, à rencontrer les étudiants à la rentrée et à voir au cheminement scolaire des étudiants. Les raisons ayant motivé son choix est son plaisir à côtoyer les étudiants et son désir de mieux connaître les rouages administratifs du département et du programme. Les premiers contacts avec les étudiants lui procurent toujours, après 25 ans d’enseignement, un certain trac. Les premières semaines servent à établir une chimie entre le professeur et les étudiants. Mme Baillargeon favorise l’interaction dans la classe, ce qui démontre l’intérêt des étudiants et leur compréhension de la matière. Elle aimerait bien donner éventuellement le cours d’histoire du Canada après 1850 de première année, si toutefois sa collègue Michèle Dagenais veut bien lui céder sa place! Ses cours visent principalement à développer des habiletés à rédiger, à analyser et à penser. Le contenu devient alors un prétexte pour atteindre ces objectifs.
Selon elle, la condition de la femme s’est nettement améliorée en Occident
au cours des dernières années. Il reste tout de même à régler certains
problèmes de l’Orient qui deviennent, avec l’immigration, des problèmes
occidentaux. Par exemple, le port du voile et l’excision sont considérés par
plusieurs comme une atteinte aux droits des femmes et sont des débats présents
dans nos sociétés. Cependant, concernant la pauvreté, Mme Baillargeon nous
fait remarquer que celle-ci se féminise. La marche des femmes contre la pauvreté
est donc amplement justifiée. Quant à la famille, elle est, selon notre éminent
professeur, en mutation comme toujours. La « crise » de la famille
n’est donc pas nouvelle et on peut trouver du bon dans nos familles actuelles.
Concernant la possibilité de rémunérer les femmes au foyer, Mme Baillargeon nous met en garde : « C’est une lame à deux tranchants. » En effet, on paie la personne qui s’occupe des enfants le jour mais on ne paie pas la mère qui reste à la maison pour éduquer ses enfants. Toutefois, un salaire pour ces femmes pourrait engendrer un recul de la condition féminine puisque ces dernières seraient mises à l’écart du marché du travail. Elle soutient cependant que ce dernier devrait s’assouplir et permettre aux travailleurs de se consacrer à la fois à la famille et au travail sans pénalité. Elle ajoute qu’on pourrait rémunérer une personne (homme ou femme) qui prend un temps d’arrêt d’une durée quelconque pour prendre soin de ses jeunes enfants et ne pas pénaliser par la suite leur carrière lors d’un retour au travail. Le terrible débat concernant la publicité dans les établissements scolaires rencontre une autre opposante en Denyse Baillargeon. En effet, elle n’apprécie pas l’envahissement de la publicité et du marchandage dans nos vies et dans le milieu scolaire. Celui-ci devrait être un lieu hors du monde dans lequel on pourrait se consacrer à notre formation sans être dérangé par des images agressantes ou des messages insidieux. On ne pouvait éviter de la questionner sur son opinion face au départ de M. Ingersoll. Elle respecte son choix puisque, étant un homme de principes, il va au bout de ses idées et opinions. Elle n’aurait pas pu faire la même chose. Cependant, elle ne croit pas que cela va servir la cause puisque plusieurs peuvent croire qu’un autre motif aurait inspiré sa décision de partir. Elle mentionne également que le département a perdu un gros morceau. Comme la plupart des chercheurs en histoire du Canada, Denyse Baillargeon est membre de l’Institut d’histoire de l’Amérique française (IHAF). Il est l’équivalent d’une association professionnelle. Le rôle de cet institut est de promouvoir et défendre l’histoire ainsi que de publier la Revue d’histoire de l’Amérique française. Le rôle actuel de Mme Baillargeon, qui siège au comité de rédaction, est de sélectionner les textes qui seront publiés. Notre professeur est récipiendaire du prix Guy-Frégault pour un article publié en 1996. L’importance des prix en histoire est certes moindre que dans certains domaines et certains prix sont plus prestigieux que d’autres, mais ils représentent tout de même la reconnaissance des pairs et flatte l’ego! La rédaction de livres en anglais est devenue une nécessité déplorable pour les chercheurs québécois. En effet, s'ils veulent rayonner à l'extérieur du Québec, ce que l'université oblige, ils doivent publier dans la langue de Shakespeare. Cependant, cela entraîne une diminution des livres en français disponibles pour les étudiants. L'expérience de Mme Baillargeon lors de conférences à l'étranger lui a permis de constater que notre histoire comporte des particularités qui fascinent les historiens d'ailleurs. Les publications en anglais permettent donc de faire connaître notre histoire à travers le monde. Consciente du peu d’implication, dans les années antérieures, des étudiants, Mme Baillargeon souhaite une longue vie au journal Le Sablier et à l’association étudiante. Merci, Mme Baillargeon, pour cet entretien très agréable. Vous êtes désormais une des vedettes interviewées pour notre humble journal! |