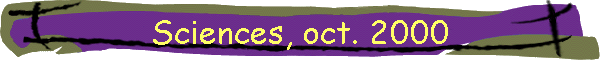Parce qu’il faut commencer quelque
part…
Par Daniel Lachapelle Lemire
le_gars_de_poly@hotmail.com
Cette chronique, qui voit maintenant le jour sous vos
yeux ébahis, est vouée à l’exploration du monde fascinant des articles rédigés
à deux heures de l’heure de tombée. Ce qui est bien, c’est que cette
chronique, si elle reçoit l’aval de la rédaction, vous permettra
d’apprendre des tas de choses sur l’histoire, en particulier l’histoire
des sciences. De plus, si vous êtes tous très gentils…
Bon, mettons quelque chose au clair des maintenant : les textes du genre
« mes très chers(chères) consœurs et confrères », ça fait pas
trop joli. Et puis montrer une différence pour donner l’impression d’unité,
moi, ça me semble un peu trop hypocrite. Nous allons donc nous entretenir en
employant le genre de la véritable puissance sur Terre…
Donc, si vous êtes toutes très gentilles, vous aurez également des histoires
de Sundae, ma chatte. Vous vous demandez sûrement si je vais être capable
d’arriver au bout de cette chronique avec ce qui peut ressembler à du matériel
plutôt léger, mais je vous réserve une de ces surprises…
Serait-ce qu’un peu de curiosité
pointe en vous?
Pour
la petite histoire, j’ai passé trois (longues) années en génie informatique
à l’École Polytechnique de Montréal. J’y ai appris une myriade de choses :
de la physique, des mathématiques, de la chimie, des mathématiques, de
l’informatique, des mathématiques… Bref, une solide formation de « matheux »
qu’envierait n’importe qui ayant un besoin pressant d’une mort horrible,
douloureuse et inhumaine. À la question : « Est-ce que ces mathématiques
sont toutes importantes à la carrière d’ingénieur? », je réponds :
« Pas vraiment ». Certaines ingénieures ne vont jamais faire plus
de mathématiques hormis la règle des trois, alors que d’autres vont passer
le reste de leur vie à faire de l’algèbre. Mais il n’en a pas toujours été
ainsi. Il fut un temps où les mathématiques étaient une partie majeure de la
formation en ingénierie. Pour mieux s’en rendre compte, il vaut mieux se
transporter quelques siècles en arrière, soit au 18e siècle, à
Paris.
C’est en effet dans une Paris en pleine effervescence post-révolutionnaire
qu’est née l’École polytechnique. Institution scolaire renommée, c’est
là que s’est vraiment concrétisée l’institutionnalisation de l’ingénieur.
Je m’explique : avant la création de l’École polytechnique, il
existait bien des hommes de science qu’on aurait pu considérer comme « ingénieurs ».
Ils construisaient des ponts, des machines de siège et autres gadgets
sophistiqués. Pour ce faire, ils utilisaient des mathématiques plus ou moins
rudimentaires, quelques connaissances (ou intuitions) de physique et surtout
beaucoup de temps : ils étaient pour la plupart des « patenteux ».
Ce n’est qu’avec la Convention de 1794, qui mena à la naissance de l’École
Polytechnique, « l’X », en 1795, que l’on a reconnu le besoin
d’une élite scientifique française.
Les élèves de l’École étaient recrutés par un concours de mathématiques
et ils étaient logés et payés (900 francs par an) aux frais de l’État. De
la toute première promotion émergèrent d’éminents scientifiques :
Poisson, Biot et Gay-Lussac, pour ne nommer que ceux-là. Dès le début,
l’accent a été mis sur l’enseignement des mathématiques, de la physique
et de la chimie, le tout en vue de faire des scientifiques compétents et
polyvalents. Il était d’ailleurs courant de voir de jeunes prodiges des mathématiques
faire leurs études de deux ans de génie et ensuite devenir professeurs à leur
tour. Parmi ceux-ci, on compte Arago, Cauchy, Petit, Dulong et Gay-Lussac. Il
est à noter que les premiers enseignants de 1795 étaient tous de l’Ancien Régime,
où la place accordée aux sciences appliquées (le domaine de l’ingénieur)
était à peu près nulle (les « nobles sciences » étant la
physique, la chimie et les mathématiques). Cela explique pourquoi les premiers
gradués de l’École firent carrière en enseignement plutôt qu’en génie.
Alors qu’à l’origine l’École polytechnique formait des ingénieurs
civils (son premier nom est « École centrale des travaux publics »),
Bonaparte a associé l’X à l’armée en 1804 en lui imposant un régime
militaire : uniforme, caserne, cours d’artillerie, etc. Le retour à la
vie civile ne se fera qu’entre 1816 et 1817 par le licenciement de toute l’école
par le roi Louis XVIII. L’École a éventuellement repris son statut militaire
en 1830, statut qu’elle ne perdra qu’en 1940. Soulignons qu’entre ces deux
années, l’École a formé de nombreux haut-gradés (dont les quatre maréchaux
de France qui ont conduit à la victoire de 1918) et même un prix Nobel, le
physicien Henri Becquerel.
***
Vous savez qui était Henri Becquerel? Disons seulement que Pierre et Marie
Curie et lui ont tué des centaines de personnes et ont causé des milliers de
malformations en Europe après Tchernobyl. Quoi? Ils étaient tous trois morts
depuis longtemps lors de l’accident? Si on suppose que les Chinois n’avaient
jamais dévoilé à quiconque le secret de la poudre à canon, pensez-vous que
John F. Kennedy serait mort à l’heure qu’il est? Certes, quelqu’un
d’autre aurait peut-être découvert les radiations à leur place, mais… ah!
Laissez tomber.
***
J’ai un grave problème : Sundae tète le tapis de la salle de bain jour
et nuit! Elle fait un bruit atroce! Je ne sais plus quoi faire! JE VEUX DORMIR!
Si vous avez une solution (non-violente) ou si vous pouvez me rivaliser avec une
bizarrerie animale (ou pour toute question, angoisse ou interrogation
existentielle), écrivez-moi à :
le_gars_de_poly@hotmail.com
Haut de la page
Index - Sciences