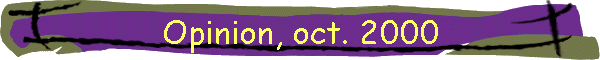(Les)
Problèmes d’histoire
Par
Mathieu Le Blanc
mat.leblanc@sympatico.ca
Si l’Université de Montréal voit son nombre d’étudiants
augmenter cette année, il en est tout autrement pour le département
d’histoire. En effet, la baisse du nombre de premières années (mineur,
majeur et baccalauréat) continue pour une X e année consécutive.
Si pour plusieurs cette statistique ne reflète qu’un creux dans une
vague qui remontera bien un jour, je crois au contraire que cette baisse légère
ne fera que s’accentuer au cours des prochaines années et ce, à cause de
plusieurs facteurs.
Premièrement, le réseau collégial a vu, cette année, ses inscriptions
baisser substantiellement. Les raisons évoquées pour justifier cette baisse: dénatalité
et augmentation du décrochage. Si présentement l’Université de Montréal
voit augmenter le nombre de ses étudiants, à la longue il y aura sûrement une
baisse. C’est logique. Alors si présentement nos inscriptions baissent alors
qu’il y a une augmentation dans le réseau, imaginez lorsque les inscriptions
de l’ensemble des facultés de l’Université de Montréal baisseront.
Cette baisse peut-être expliquée par des facteurs internes à
l’Université de Montréal et au département d’histoire. Pour la majorité
des étudiants qui commencent des études universitaires, un emploi lié au
domaine de spécialisation devrait normalement couronner leurs études. Pour les
futurs historiens, l’avenir est loin d’être aussi aisé. Avec un bac en
histoire, l’étudiant diplômé aura peu de chances de se trouver un emploi lié
au métier d’historien ; pour enseigner au secondaire, il faut un bac en enseignement.
Ce bac, d’ailleurs, fut dénoncé par plusieurs professeurs et chargés de
cours (notamment l’article publié dans Le Devoir l’an dernier auquel
participait Michel de Waele), car il donnait une formation bien incomplète aux
futurs enseignants. Pourquoi ne pas offrir une solution de rechange, comme des
finissants au bac en histoire ayant complété leur formation par un certificat
en enseignement ?
Pour l’enseignement collégial, il faut une maîtrise et il est
difficile d’y accéder vu la quantité de postes disponibles. L’histoire est
nécessairement un tremplin vers une autre discipline: sciences politiques,
archivistique, sciences de l’information, journalisme, etc. Donc, un étudiant
va avoir tendance à faire un mineur ou un majeur pour se diriger ensuite dans
une spécialisation voulue.
Un étudiant va à l’université pour se spécialiser et non pour avoir
nécessairement une formation de culture générale, même si elle s’avère
extrêmement profitable. Le programme du baccalauréat en histoire de l’Université
de Montréal est présentement fait pour une minorité d’étudiants qui
cherchent à développer une culture générale. Une personne intéressée à
une phase plus spécifique du monde, une ère spatio-temporelle, va choisir un
programme plus spécifique. Par exemple, un étudiant intéressé particulièrement
au Moyen Âge va s’inscrire en études médiévales (ETM). Cette situation
n’est peut-être pas nouvelle en ce qui concerne les programmes d’études
classiques et médiévales, mais la création de programmes bi-disciplinaires
(relations internationales, par exemple) draine des étudiants du programme
d’histoire.
Le bac en histoire s’est amélioré au cours des dernières années.
L’ajout du bloc langues, il y a deux ans, permet à l’étudiant d’utiliser
des crédits pour se spécialiser dans un groupe linguistique qu’il soit
vivant ou mort (le latin et le grec ancien). Il faut continuer dans cette route.
Tout en voulant donner une formation générale de base en histoire, l’étudiant
devrait pouvoir facilement se spécialiser au cours de son bac. Il faut donc
permettre une meilleure convivialité entre les différents programmes de la
Faculté des Arts et Sciences (F.A.S.). Ce qu’il y a de merveilleux avec l’Histoire,
c’est que tout ce ramène à l’Histoire. Les étudiants devraient donc
pouvoir se faire créditer des cours hors département facilement. Le bloc Y
permet déjà certains cours hors département, mais le choix est trop
restreint. Par exemple, tous les cours ETM devrait se retrouver dans ce bloc et
non seulement deux. C’est la même chose avec les cours de philosophie ainsi
que plusieurs autres. Sans être un programme fourre-tout, le bac spécialisé
se doit de permettre à l’étudiant de se spécialiser, il doit avoir le
choix.
Il ne s’agit pas de faire une réforme majeure. Voici quelques
suggestions qui faciliteraient les échanges entre les disciplines et une
meilleure spécialisation. Premièrement, il faudrait enlever tout les maximums
dans les blocs. Un étudiant qui veut se spécialiser en Europe contemporaine
devrait pouvoir prendre plus que deux cours de deuxième année sur cette époque.
Ensuite, il faudrait élargir la banque de cours du bloc Y, comme je le disais
précédemment, pour pouvoir donner le choix à l’étudiant de se spécialiser.
En bref, il faudrait être beaucoup plus souple pour que l’étudiant puisse
profiter pleinement de ses études. Si nous n’apportons pas de solutions,
d’autres vont le faire à notre place et à nos dépends.
Haut de la page
Index - Opinion