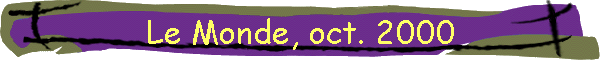UN
DE CES CRIS SILENCIEUX
Par David Murray
On ne le dira jamais assez. Le processus de
mondialisation en cours vise une appropriation de la richesse par quelques-uns
et un appauvrissement global pour le reste de la population. Ceci s’effectue
à l’échelle de la planète entière et est présenté comme étant une phase
normale dans l’évolution historique. Suivant ce schéma, les gouvernements,
partout dans le monde, se font les complices de cette tyrannie financière et ne
sont plus désormais que les agents des grandes firmes étendant leur emprise
sur l’ensemble du monde. Face à l’extension de l’ombre néolibérale, il
surgit toutefois des cris refusant cette implantation déshumanisante, mais qui
réussissent malheureusement difficilement à se faire entendre.
Dans l’un des États les plus pauvres du Mexique, le
Chiapas, situé dans le sud-est du pays, un de ces cris de révolte a émergé
et lance un appel à tous les damnés de la terre. Sous l’étendard d’Emiliano
Zapata, un des leaders de la révolution mexicaine, le mouvement zapatiste
refuse l’accaparement de la planète par une petite clique sans scrupule et à
la faim inassouvie. C’est à l’occasion de l’entrée en vigueur de l’Accord
de libre-échange nord-américain (ALENA), le 1er janvier 1994, que
l’on entendit pour la première fois parler des zapatistes. Ayant choisi cette
date symbolique, l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN), formée
presque essentiellement d’indigènes, lança une insurrection dans quatre
municipalités de l’extrême sud du pays. Après quelques affrontements
sanglants avec les forces gouvernementales, ces dernières déclarèrent, le 12
janvier 1994, un cessez-le-feu, en plus de proposer une amnistie et une
ouverture du dialogue, en voyant l’appui que recevait l’insurrection
zapatiste dans la société civile. Depuis ce temps, malgré le fait que le
Chiapas demeure l’un des points chauds de l’Amérique latine et que des
troupes fédérales soient toujours stationnées aux frontières de cet État,
l’EZLN est restée pratiquement inactive militairement. Sachant parfaitement
qu’ils ne peuvent briser le pouvoir établi par la force, les zapatistes
veulent utiliser leur armée en tant que force politique et non militaire.
Paradoxalement, cette armée a pour objectif de cesser de l’être. Comme
l’affirmaient des délégués de l’EZLN lors d’une visite à Paris :
« Le 12 janvier 1994, en écoutant
ce que nous disait la société civile mexicaine, nous avons fait un choix stratégique
: transformer une armée en une force politique nouvelle pour ouvrir vraiment le
chemin à la transition pacifique et à la démocratie ».
À l’origine, l’insurrection zapatiste visait des
objectifs plutôt nationaux. En effet, celle-ci avait pour principales
revendications l’autonomie des indiens, la redistribution des terres aux
paysans et la justice et la liberté pour tous. Toutefois, à l’instigation du
sous-commandant Marcos - véritable leader et penseur du mouvement, qui n’est
toutefois pas indien bien que sa véritable identité reste inconnue - et du
Comité clandestin révolutionnaire indigène (CCRI) - véritable direction
politique du zapatisme, constitué fin 1993 - l’EZLN se propose de dialoguer
avec les différentes forces antilibérales du monde et de situer les
aspirations zapatistes dans une perspective internationale. C’est notamment
dans ce contexte que l’EZLN organisa, du 27 juillet au 3 août 1996, une
rencontre intercontinentale afin de débattre des façons possibles de remédier
à un monde avançant à sens unique.
Dorénavant, donc, les revendications zapatistes ont
une connotation plus universelle et trouvent un écho favorable à travers le
monde. Comme le soulignait notamment l’écrivain uruguayen Eduardo Galeano,
dans une lettre au sous-commandant Marcos : « Son
cri a une résonance universelle parce qu’il exprime une passion pour la
justice et une vocation solidaire qui défient le système dominant. »
Promouvant la diversité des cultures et les échanges entre celles-ci, le
zapatisme propose comme alternative au modèle dominant un système basé sur la
démocratie participative et sur la solidarité sociale. Il appelle à une
organisation de la société civile afin de lutter contre l’oppression des
marchés financiers, véritables maîtres du monde. Aussi, comme le souligne le
sous-commandant Marcos : « le
zapatisme se veut un défi, défi à un monde déshumanisé. Mais il ne veut
surtout pas être un nouveau dogmatisme. » En effet, ce dernier,
conscient qu’il n’existe aucune solution miracle pour remettre sur la bonne
voie un monde qui est de plus en plus complexe, favorise le dialogue entre
toutes les tranches de la société. De plus, ce qui singularise le zapatisme et
qui lui permet de s’attirer de nombreuses sympathies, c’est que comme tout
bon mouvement de résistance, il ne cherche pas à prendre le pouvoir. Suivant
cet idéal, il appelle tous les mouvements antilibérales de la planète à
s’engager dans « une volonté de résistance
au « nouvel ordre mondial » et au crime que représente cette 4e
guerre mondiale » (après les deux premières sans besoin de présentation
et la guerre froide).
Confiné au cœur de la jungle chiapanèque, les
zapatistes ont donc entreprit de refuser le modèle dominant et de tenter une
nouvelle avenue au sein de leurs quelques communautés autonomes. Toutefois, ce
cri de révolte, comme plusieurs autres à travers le monde, n’arrive toujours
pas à se faire entendre, le gouvernement préférant de beaucoup la disparition
de l’EZLN à un dialogue avec l’organisation. Cependant, l’exemple des
zapatistes, comme celui de tant d’autres, devrait favoriser le soulèvement de
la société civile face au monopole de la pensée unique afin de permettre une
reconquête concrète de la citoyenneté et, par le fait même, empêcher que
l’appel des zapatistes ne demeure un cri silencieux, comme le sont trop
souvent malheureusement les cris des opprimés.
Haut de la page
Index - Le Monde