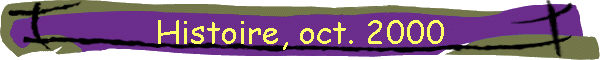Félix-Gabriel
Marchand, d’homme de lettres à homme politique.
Par Stéphanie Charland
Dans cette parution, je vais continuer avec une autre mini-biographie sur
l’un de nos ex-Premiers ministres. Félix-Gabriel Marchand est un homme de
grande qualité. Le parcours qu’il a complété tout au long de sa vie, fait
de lui un être d’exception. Cet homme, peu commun, a mené à la fois les
carrières de notaire, de politicien et d’homme de lettres.
Félix-Gabriel
Marchand voit le jour le 9 janvier 1832. Né d’une mère anglophone, il entre
comme élève au St. John’s Classical School en 1840. Puis, à l’âge de 11
ans, il fait son entrée au Collège de Chambly et un an plus tard, au Collège
de Saint-Hyacinthe. En 1850, il devient clerc-notaire à
Saint-Jean-sur-Richelieu. Toujours avide de savoir, il part en France poursuivre
des études en littérature. À son retour, il continue ses études de droit et
est admis à la pratique notariat le 20 février 1855. En 1891, grâce à ses écrits,
il reçoit le grade de docteur honoris causa en Lettres de l’Université de Laval.
À la mort de son père en 1852, il devient propriétaire terrien, tout
en continuant le notariat jusqu’en 1899. En 1860, il est élu au poste de trésorier
de la Chambre des Notaires du district d’Iberville qu’il occupa jusqu’en
1870. Puis, en 1894, c’est à la Chambre des Notaires de Québec qu’il est
élu président. C’est le 1er avril 1899 qu’il signe son 6324ième
et dernier acte notarié.
Il se lance aussi en affaire : il fonde, avec Louis Malleur, la
Banque de Saint-Jean en 1873. En plus, de 1875 à 1876, il sera directeur de la
compagnie manufacturière de Saint-Jean ainsi que promoteur et associé de la
St. John’s Building Society et de la St. John’s Woolen Factory.
Marchand à aussi fait une carrière militaire. De 1862 à 1866, il fut
lieutenant, capitaine, major et lieutenant-colonel du 21e bataillon
d’infanterie légère de Richelieu. En 1866, il fonde, avec Charles-Joseph,
une compagnie d’infanterie de milice volontaire, les Chasseurs
du Richelieu. Durant le raid des Fenians en 1870, il commande cinq
bataillons. Il sera actif militairement jusqu’en 1880. Il est même nommé
officier de la Légion d’Honneur en 1898.
Durant sa vie, il a aussi été homme de lettres. Comme journaliste, il
travaille à la Ruche littéraire et politique en 1853 et 1854. C’est ainsi
qu’il voit dans les journaux un moyen exceptionnel de communication. Ainsi,
avec le concours de partenaires, il fonde à Saint-Jean-sur-Richelieu, Le
Franco-Canadien, où il sera rédacteur en chef jusqu’en 1885. En 1883, il
fonde aussi Le Temps de Montréal et en 1893 le Canada Français. Il participe aussi à d’autres journaux comme Le
Foyer Canadien, La Revue Canadienne, Le Littérateur Canadien, La Revue légale
et L’ordre. En tant qu’homme de lettres, il est l’auteur de
plusieurs pièces de théâtre telles Fateville
(1868), Erreur n’est pas compte
(1872), Un bonheur en attire un autre
(1883), Le Lauréat (1885), qui est un
opéra comique et Les Faux Brillants
(1885). Il publie aussi Manuel et
formulaire du notariat (1892) et Mélanges
poétiques et littéraires (1899).
Il a aussi œuvré dans plusieurs organismes. Il est élu président de
la Société de construction de Saint-Athanase d’Iberville puis au poste
de directeur de la Société d’Agriculture du comté de Saint-Jean en 1861.
Par surcroît, en 1863, il se mérite le poste de vice-président et en 1864
celui de président. Au sein de la Société Royal du Canada, il passe de membre
à sa fondation en 1882, à vice-président et à président en 1898. En 1883,
il est membre de l’Académie des Muses Santones de France et décoré des
Palmes d’officier de l’Académie du gouvernement français. En plus, il est
président de la Société de la Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean en 1885.
Sa carrière politique est aussi bien remplie et le mène jusqu’à la
toute fin de son existence. En 1858, Marchand entre en politique municipale :
il est élu conseiller de sa ville, Saint-Jean-sur-Richelieu. En 1863, il est élu
président de la Commission Scolaire de la paroisse de Saint-Jean l’Évangéliste
et il le restera jusqu’en 1896. En 1867, il est élu député libéral à l’Assemblée
législative dans la circonscription de Saint-Jean. Il est membre du conseil de
réforme du Parti national et membre exécutif du Parti en 1875. Dans le cabinet
Joly de Lotbinière, de 1878 à 1879, il sera secrétaire et registraire de la
province. Ensuite, il est
commissaire des Terres de la Couronnes en 1879. Il occupe le poste convoité
d’orateur à l’Assemblée législative de 1887 à 1892. De 1892 à 1897, il
est chef de l’opposition dans le Parti libéral. Puis, enfin, il est élu
Premier ministre du Québec en 1897 et le reste jusqu’à sa mort en 1900.
Homme de la fin du 19e siècle, il ne vivra pas assez longtemps pour voir
l’héritage politique qui le suivra. En effet, le long règne des libéraux
commença avec lui en 1897 et se termina en 1936 avec Alexandre Taschereau. Mais
cet héritage n’est pas que politique. Les journaux qu’il fonda contribuèrent
à informer les gens. De plus, les pièces de théâtre qu’il a écrit ont
fait de lui un homme de talent et un artiste. Artiste réfléchi, il n’en
resta pas moins un homme qui œuvra dans sa communauté. Il fit du comté de
Saint-Jean, son cheval de bataille où il fonda plusieurs sociétés
(militaires, financières, agriculturales…). Pour tout idéaliste, il est un
exemple à suivre.
Haut de la page
Index - Histoire