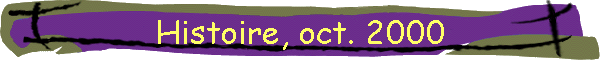
|
|
|
Historique
de la Faculté de musique
Par Julie Bellemare L’époque Morin¾Papineau-Couture: la musique sacrée
Fondée le 18 octobre 1950 à la demande du cardinal Paul-Émile Léger
pour former des musiciens d’église, la Faculté de musique est d’abord sous
le rectorat de Mgr Olivier Maurault. C’est le doyen Alfred Bernier qui non
seulement organise et administre les programmes d’études et de recherche,
mais assure la coordination des programmes d’études et des grades dans les écoles
de musique jusqu’alors affiliées directement à l’Université de Montréal
(le Conservatoire national de musique, l’École normale de musique, l’École
de musique Vincent-d’Indy, les écoles de Lachine, de la Présentation-de-Marie
à Saint-Hyacinthe, des sœurs de l’Assomption de Nicolet, la Schola Cantorum
de Montréal, l’École de musique de Sherbrooke, l’École supérieure de
musique de Hull et le Collège de musique Sainte-Croix de Saint-Laurent).
Les cours débutèrent le 1er février 1951. Le
programme d’enseignement se divisait, à ce moment-là, en deux sections, la
musique sacrée et la musique profane, et offrait une formation générale. Les
seuls instruments enseignés alors étaient le piano et l’orgue. En 1953, Éthelbert
Thibault succéda à Alfred Bernier pour un court mandat et Jean
Papineau-Couture, à titre de secrétaire de la Faculté, en assuma la direction
par intérim jusqu’en 1955.
Jean Papineau-Couture agit comme doyen par intérim
entre 1953 et 1955, en l’absence de monsieur Clément Morin, p.s.s., étudiant
alors à Rome, et à qui revenait la direction de cette jeune école. Fin
diplomate, il profite de ces circonstances pour transformer la Faculté en un véritable
lieu de formation scientifique et de réflexion sur la création de la musique
profane. Il ajoute au programme initial un ensemble de cours pour mieux
comprendre le phénomène musical dans sa réalité sonore (acoustique, analyse,
harmonie, solfège tonal et atonal).
Clément Morin devint doyen en 1955 et instaura,
la même année, en plus des cours réguliers, un programme destiné aux
musiciens d’église et, en 1961, ajouta des cours de pédagogie musicale. En
13 ans de gestion, M. Morin allait accomplir un important travail de
stabilisation et consacrer l’uniformisation des programmes d’études des écoles
affiliées. C’est en 1966 que se produisit un véritable éclatement des
programmes menant à l’obtention d’un B. Mus. Général, interprétation,
composition, techniques d’écriture et musicologie. En 1967, c’est également
sous le tandem Morin – Papineau-Couture qu’eurent lieu les difficiles
discussions qui menèrent, suite aux recommandations du rapport Parent, à la
dissolution des écoles de musique affiliées à l’Université de Montréal.
Une nouvelle impulsion est donnée à la Faculté:
elle obtient des locaux plus vastes, le nombre de professeurs à temps plein
passe de 6 à 18, les programmes sont plus souples et plusieurs activités
d’expression et de rayonnement se développent. Les Nocturnales
sont créées en 1968 et permettent aux membres de la Faculté de présenter,
à une heure tardive, des concerts d’œuvres traditionnelles ou
contemporaines, parfois même des créations, dans un cadre où l’élément
sonore s’enrichissait souvent d’éléments visuels. En 1969, les Musialogues,
des entrevues avec des personnalités du monde artistique canadien et
international sont animées à la radio française de Radio-Canada par Maryvonne
Kendergi. Durant la même période, les ateliers de musique ancienne, de musique
baroque, de musique contemporaine, de jeu scénique et de jazz se produisent
aussi bien à la Faculté qu’à l’extérieur.
« Jean Papineau-Couture doit alors affronter le courant des
contestations issues de mai 68, car les étudiants réclament une gestion plus
collégiale et des modifications substantielles aux programmes », relate
Marie-Thérèse Lefebvre, musicologue et professeure à la Faculté. À leur
demande, il dépose sa démission et, devant l’incapacité à le remplacer
dans l’immédiat, il accepte en 1972-1973, d’assumer une seconde fois
l’intérim jusqu’à la nomination du nouveau doyen, Gilles Manny. La Faculté
était désormais sur la voie du développement. De Gilles Manny à Pierre Rolland: la Faculté s’ouvre à la musique populaire et au jazz
Gilles Manny (1973 à 1979) entreprit une
refonte des structures pédagogiques et administratives pour implanter un type
collégial de gestion. Le nombre de professeurs passe à 25 et celui des
inscriptions à plus de 400, en 1979. L’accent est mis, en particulier, sur le
développement des études de deuxième et de troisième cycles, suite à la création
de la Faculté des études supérieures et à l’établissement de programmes
de recherche.
La crise économique qui marqua les années
quatre-vingt toucha durement le secteur de l’éducation et ce sont les doyens
Henri Favre (1979-1984) et Pierre Rolland (1984-1988) qui eurent alors la
difficile mission de gérer la Faculté. C’est aussi durant cette période que
la Faculté s’ouvrit à la musique populaire et au jazz en offrant un
programme d’études dans ce secteur, grâce à l’initiative des professeurs
Robert Leroux et René Masino. Avec l’arrivée de Marc Durand, les classes de
piano allaient également connaître une ascension fulgurante et produire
plusieurs excellents pianistes.
En 1980, pour répondre à un besoin
d’expansion, la Faculté fit l’acquisition du pavillon de l’École de
musique Vincent-d’Indy. Les étudiants auront accès, dès 1983, à une
audiothèque, une bibliothèque, trois salles de concert et un équipement
audiovisuel élaboré, notamment des studios de recherche en composition électroacoustique
ainsi qu’un studio d’enregistrement de type professionnel. La même année,
la Faculté devient dépositaire des archives et documents du bureau de Montréal
de l’Encyclopédie de la musique au Canada. À la clôture d’Expo’86 à
Vancouver, le gouvernement indonésien fait don à la Faculté d’un gamelan
balinais et, depuis, une formation est offerte aux étudiants dans cette
discipline. À partir de 1988, le rayonnement devient une priorité
Robert Leroux occupera le poste de doyen de 1988
à 1997. Ce dernier mettra l’accent sur le développement du corps professoral
et sur le rayonnement extérieur de la Faculté. En 1989, le Nouvel Ensemble
Moderne (NEM), dirigé par Lorraine Vaillancourt, est nommé ensemble en résidence.
En 1991, le corps professoral met sur pied l’étiquette de disques UMMUS (qui
deviendra Amberola en 1998) dont le rôle est de mieux faire connaître les
travaux des interprètes et des compositeurs de la Faculté. L’OUM, sous la
direction de Jean-François Rivest, reprend aussi ses activités en 1993. Ses
premiers concerts lui valent des critiques élogieuses ainsi qu’une invitation
pour une tournée de concerts en Espagne, en 1994. Sous l’initiative de
Monique Desroches naît le Laboratoire de recherche sur les musiques du monde
qui génère une importante activité de recherche sur les musiques de
traditions orales et contribue au développement de liens internationaux. Outre
ces réalisations, des programmes de Diplôme d’études supérieures spécialisées
en interprétation et en répertoire d’orchestre sont créés.
En 1998, Réjean Poirier accède au poste de
doyen et modifie les portefeuilles de direction en nommant une nouvelle équipe
qui aura pour mandat de développer des partenariats, établir des stratégies
de recrutement ciblé, développer le corps professoral, favoriser l’intégration
des nouvelles technologies dans la pédagogie, accroître les fonds de bourses
aux étudiants et augmenter la visibilité de la Faculté. Le secteur musique du
Service des activités culturelles (SAC) s’installe dans les murs de la Faculté
et la salle Claude-Champagne est désormais administrée par la Faculté.
Finalement, la chorale devient le Choeur de l’Université de Montréal.
Les fêtes du 50e anniversaire, par leur
rayonnement, se veulent une activité de mise en valeur et de reconnaissance
envers tous ceux qui ont édifié cette faculté.
Dans le cadre du 50e anniversaire de la Faculté de musique de l’Université de Montréal, voici une série de concerts qui auront lieu au cours de la prochaine année: Dimanche
22 octobre 2000 à 20 h: récital de José Van Dam (baryton-basse) à la
salle Claude-Champagne, 220, avenue Vincent-d’Indy, à Montréal. Billets
disponibles au (514) 842-2112 ou sur le réseau Admission au 1-800-361-4595. Jeudi
23 novembre 2000 à 20 h: récital de piano de Stéphan Sylvestre à la
salle Claude-Champagne, 220, avenue Vincent-d’Indy, à Montréal. Billets
disponibles au (514) 842-2112. Jeudi
1er mars 2001 à 20 h: récital de piano de Sylviane Deferne à la salle
Claude-Champagne, 220, avenue Vincent-d’Indy, à Montréal. Billets
disponibles au (514) 842-2112. Samedi
31 mars 2001 à 20 h: récital de piano de Alfred Brendel à la salle
Claude-Champagne, 220, avenue Vincent-d’Indy, à Montréal. Billets
disponibles au (514) 842-2112. Pour plus d’informations sur ces activités ou
sur les autres événements se rattachant aux festivités du 50e anniversaire de
la Faculté de musique, contactez Julie Bellemare au (450) 224-8866 ou par
courriel: juliebellemare@videotron.ca |