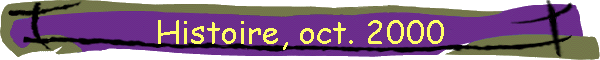Traité sur la démocratie athénienne
Par
Chad D. Dubois
Il est un héritage dont la civilisation occidentale peut se targuer de
nous avoir légué et qui demeure plus vivant que jamais dans nos institutions.
Cet héritage, c’est la tradition démocratique qui a lentement vu le jour au
cours de la période archaïque (~800 À ~500 av. J.C.) en Grèce continentale
et s’est épanouie sous Périclès à Athènes au Ve siècle av.
J.C.. Les réformes politiques entreprises par Solon, Dracon et plus tard par
Clisthène en 508-507 av. J.C. suite au règne du tyran Pisistrate (~548-547 à
528 av. J.C.) visaient à en arriver à une séparation plus équitable du
pouvoir et amener davantage de citoyens à exercer des droits politiques. Or,
ces réformes comportaient des lacunes par le fait qu’elles favorisaient une
certaine concentration du pouvoir entre les mains de l’aristocratie et
interdisaient à une large part des habitants d’Athènes un accès au
politique de la Polis, la cité.
À l’échelle de l’histoire humaine, la démocratie demeure une création
empirique des Athéniens. D’emblée, le cadre géographique des cités
grecques ainsi que les tendances individualistes, voire nombrilistes de
celles-ci ne pouvaient que favoriser l’émergence de différents systèmes
politiques. D’autre part, la tradition des discussions publiques, si propices
dans un climat qui s’y prête comme celui de la Grèce, ne favorise pas la
constitution d’un pouvoir central fort comme le sont les monarchies.
L’historique
La chute de la tyrannie en 510 sous Hippias, moins habile et diplomate
que ne pouvait l’être son illustre père, Pisistrate, précipita la
transition d’Athènes vers la démocratie dans un climat d’euphorie général.
Le réformateur Clisthène, précurseur des démocrates tels Éphialtès ou Périclès,
fut le législateur le plus déterminant qui allait donner un aspect si
particulier à la politique d’Athènes. D’abord, il s’affaira à diminuer
l’influence des grandes familles patriciennes de la ville. Par la suite, il
instaura différentes réformes institutionnelles visant à en arriver à une séparation
plus équitable du pouvoir selon son principe isonomique ou du moins, donner
l’illusion de l’égalité entre les citoyens en accordant un nombre de représentants
équivalents pour chaque tribu. C’est ainsi qu’il opéra de nouvelles
divisions administratives en Attique, c’est-à-dire une division en dix tribus
formant la base de recrutement des magistrats. Ces tribus étaient elles-mêmes
subdivisées en trois trittyes :
la côte, la paralie; la montagne, la diacrie
et la ville, l’astu. Enfin, les
trittyes furent divisées en circonscriptions de base nommées dème (~140 en
Attique) qui avaient entre autres pour but de faire échec aux prétentions de
la vieille aristocratie foncière au pouvoir local. En outre, Clisthène
conserva la constitution censitaire instituée par Solon consacrant une division
des Athéniens en quatre « classes » principales dont le critère
d’appartenance se bornait à la fortune personnelle en mesures de blé :
les mieux nantis, les pentakosiomedimnes
et les hippeis; les citoyens moins
favorisés, les zeugytes et les thètes
qui composaient la majorité de la population. Or, la richesse déterminait le
niveau de pouvoir auquel les citoyens pouvaient aspirer à accéder. Ainsi donc,
les thètes et les zeugytes se
voyaient refuser les magistratures les plus prestigieuses et les plus conséquentes
pour le destin de la cité. Toutefois, le recrutement des archontes fut élargi
en 487, et les zeugytes purent désormais
accéder à l’archontat.
Les assemblées athéniennes sous Périclès
L’Ecclésia,
organe majeur de la politique athénienne, était ouverte à tous les citoyens
et se tenait trois à quatre fois par mois. Chacun avait le droit de prendre la
parole pour exposer son point de vue et on s’y prononçait à main levée. Le
vote, souverain et sans appel, pouvait porter sur tous les aspects de la
politique d’Athènes. D’autre part, l’assemblée détenait un pouvoir législatif
(création de lois), électif (élection des trésoriers et des stratèges) et
judiciaires (pour les cas les plus graves comme la trahison). Aussi, elle
s’occupait d’une sanction particulière; par exemple, l’ostracisme
consistait en l’exil forcé pour dix ans les hommes susceptibles de
compromettre le système politique de la ville par ambition personnelle.
La
Boulè, ou conseil des 500, gérait la
vie politique et assurait la permanence de l’autorité politique. Elle se
composait de 500 bouleutes de dix tribus différentes dont 50 membres provenant
d’une même tribu (les prytanes), siégeaient
pendant un dixième de l’année, c’est-à-dire 36-37 jours (la prytanie),
procurant ainsi un sentiment d’égalité aux tribus. La Boulè
s’occupait du protocole entourant la réception
des ambassadeurs et de la préparation des projets de loi présentés à l’Ecclésia,
les probouleumatas.
Les limites de la démocratie athénienne
Si
la démocratie athénienne demeure ce phare séculaire du gouvernement émanant
du peuple, elle comportait plusieurs imperfections dans son application « directe ».
D’abord, elle excluait d’emblée une large part de la population, les
non-citoyens, c’est-à-dire les femmes, les esclaves et les étrangers (les métèques).
Seuls les hommes adultes nés de mère et de père athéniens pouvaient aspirer
à participer au processus politique et ainsi influencer les décisions
s’appliquant à l’ensemble de la population athénienne. D’autre part, la
constitution censitaire de Clisthène constituait à elle seule une atteinte à
la démocratie; elle ferme l’accès aux plus hautes magistratures aux citoyens
de condition modeste qui, de toute façon, ne pouvaient se permettre d’exercer
des charges qui étaient sans rémunération à l’origine. Par exemple, la
condition même de paysan empêcha nombre de ceux-ci de participer à toutes les
assemblées car ils ne pouvaient négliger leurs champs qui assuraient leur
subsistance. D’ailleurs, l’exiguïté de l’Attique ne permettait pas la
participation de tous les citoyens aux nombreuses assemblées qui rassemblent
environ 7000 personnes (en majorité des citoyens d’Athènes) sur un potentiel
de 40 000 citoyens. Aussi, comme les hautes magistratures étaient occupées par
la senior pars de la société
grecque, cette classe la plus susceptible d’avoir accès à l’éducation de
la rhétorique en cette époque où l’art oratoire permet d’influencer les
consciences, la démagogie s’exerçait facilement sur les esprits.
L’héritage de cette création empirique des Grecs
Au cours des siècles, ce modèle de gouvernement n’a cessé de hanter
la politique en Occident parce qu’elle permettait au peuple de jouer un rôle
actif dans le fonctionnement de l’État. C’est cette idée qui a maturé
dans l’esprit des élites et des penseurs à la fin de l’Époque moderne :
du Contrat social de Jean-Jacques
Rousseau à la foudroyante Révolution française, l’inspiration « primordiale »
provient de cette civilisation grecque qui continue de vivre parmi nous par nos
institutions, notre pensée et notre individualité. À l’heure de la civilisation
globale, il importe de défendre jalousement cet héritage et de le rénover
parce l’humanité est condamnée à un changement perpétuel qui ne tend pas
invariablement vers ce que nous concevons être le progrès.
Haut de la page
Index - Histoire