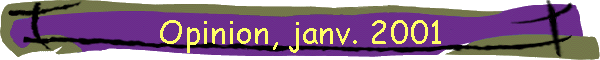À la défense de l'État-nation
Par Chad D. Deblois
Le 20 août dernier, le Washington Post publiait l'article portant ce
titre: « Koursk et Concorde, tous deux trop ambitieux pour durer ».
Il avait pour objectif de s'attaquer à deux fleurons technologiques des États-nations,
en l’occurrence la Russie et la France, traduisant clairement l’hostilité
américaine qui se manifeste contre « une volonté obsolète de puissance
de ces États ». Bien que ces deux événements nous semblent déjà
appartenir au passé, le déclin des États est bien d'actualité, car il
s'accentue de jours en jours, inexorablement effrité par le nouvel ordre
mondialisant.
Le renouveau libéral qui s’est affirmé au début des années « 80 »
avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan s’est accompagné d’un démantèlement
de l’État au profit du secteur privé alors que le consensus libéral
d’après-guerre dans les pays occidentaux s’effondrait: c’était la
privatisation. Désormais, le courant économique néo-libéral, exagérément
renforcé par les privatisations et une concentration économique croissante, prétend
dicter sa ligne de conduite aux États.
En effet, les multinationales, ces monstres issus d’une mondialisation
hypothétiquement salutaire, influencent le politique dans le sens de leurs intérêts
au détriment des populations. Ainsi, comment des États plus faibles
pourraient–ils résister aux assauts de grandes entreprises, même dans les
pays industrialisés, lorsque le chiffre d’affaire de GM est supérieur au PNB
du Danemark ou celui de Toyota supérieur au PNB du Portugal ? Et il ne s’agit
là que de constructeurs automobiles; qu’en est-il des grandes entreprises
pharmaceutiques (Bayer, Whitehall Robins, Sandoz, etc) ou des compagnies
informatiques ou de communications (Microsoft, IBM, Nortel Networks, BCE, etc. )
dont le poids économique ferait plier bien des gouvernements tant les vertus de
la nouvelle économie ont été vantées. En outre, sur les cent plus grandes
entités économiques du monde, plus de la moitié sont des entreprises privées.
Il y a donc lieu de réfléchir à ce sujet…
Le désengagement de l’État à plusieurs niveaux, encouragé par le
secteur privé, renforce le caractère individualiste de nos sociétés
capitalistes pour encourager une compétition stérile entre les individus, les
sociétés et les cultures ayant comme conséquence d’empêcher une coopération
qui serait davantage profitable pour tous. Or, la concentration économique de
plusieurs grands conglomérats leur donne les moyens d’imposer un modèle de
culture unique répandant la triste uniformité du mode de vie occidental chez
des peuples pourtant fiers de leur culture.
D’autre part, la mondialisation tant encensée par nos économistes
actuels marginalise les gestes interventionnistes des États bénéficiant à
toute leur collectivité et les considère comme une atteinte aux lois sacrées
du marché et au poison du laisser-faire qui mène à tous les excès, à
l’exploitation, aux inégalités sociales et à la spéculation boursière à
outrance. Aujourd’hui, un peu plus d’un trillion de dollars de transfert de
capitaux sera effectué à travers le monde. Or, seul 10 % de ces capitaux
seront investis dans l’économie réelle, c’est-à-dire dans la construction
d’unités de production, dans la recherche et le développement, etc. Le reste
de cette somme colossale constitue en pure spéculation, n’a donc aucun effet
dans notre vie de tous les jours et ne contribue nullement à la croissance économique.
L’économie virtuelle qui en résulte échappe donc totalement au contrôle
des États qui ne font que subir les contrecoups économiques résultant d’une
crise spéculative, par exemple. Évidemment, le développement des
communications et des transports effrite les frontières économiques entre les
différents marchés et rend d’autant plus difficile la poursuite de
politiques économiques indépendantes de la part des États, comme cela se
faisait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, le keynésianisme
ne pouvait plus être appliqué alors qu’il devenait mal vu pour un
gouvernement de gérer son économie et d’intervenir dans un monde où le libéralisme
triomphant ne permet plus qu’on gêne la « saine » compétition
entre les pays.
Mais l’arrogance du néo-libéralisme face aux revendications des
populations qui réclament de meilleures conditions de travail et qui dénoncent
la précarité d’emploi ne s’arrête pas là : l’AMI (l’Accord
Multilatéral sur les Investissements), cette autre créature issue du libéralisme
triomphant dont on continue de négocier les articles en secret, porte atteinte
à la souveraineté même des États, les restreignant en un simple gardien de
l’ordre au service du grand capital. En effet, l’AMI propose une déréglementation
quasi-totale des secteurs du travail ou de l’environnement par exemple. Il
propose aussi un retrait considérable de l’État des programmes sociaux et
des programmes de subventions, notamment en agriculture. Cela laisserait toute
la latitude aux multinationales pour commettre leurs méfaits économiques sans
aucune contrainte, car l’AMI contient aussi des clauses favorisant
l’affaiblissement du pouvoir des syndicats. En outre, cet accord octroie une
entière liberté aux entreprises en matière d’investissements, de déplacements
de capitaux et de conditions de travail, encourageant celles-ci à user de
chantage pour obtenir ce qu’elles veulent des États et du domaine politique.
L’introduction des nouvelles technologies dans les processus d’échange et
de transfert de capitaux favorise la mobilité des investissements et encourage
d’autant plus les multinationales à s’installer là où les coûts de
production sont les moins élevés et où les avantages concédés par les États
semblent plus alléchants.
La subordination du politique à l’économique consacre le déclin de
l’État-nation dans un monde globalisant où les frontières ne constituent
plus les limites des pouvoirs des super entités économiques. Or, permettre
l’affaiblissement de l’État, c’est permettre l’effritement de ces
acquis qu’en tant que citoyens, nous avons revendiqué collectivement afin
d’améliorer notre existence et afin que soient reconnus nos droits inaliénables.
En fait, l’État n’existe que par ses citoyens qui s’entendent tacitement
pour qu’un pouvoir « supra » régisse les règles de
fonctionnement de la société. Si l’État dépérit, c’est toute la
collectivité qui voit son seul outil de faire reconnaître ses droits défaillir
face au tout-puissant capital.
Salus Populi suprema lex esto
(Que le salut du peuple soit la suprême loi)
Haut de la page
Index - Opinion