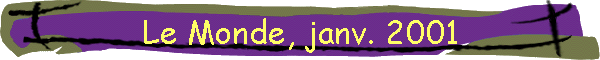Couvrir
un conflit sans en parler
Par David Murray
Depuis la visite d’Ariel Sharon sur l’esplanade des
Mosquées, le 28 septembre 2000, une nouvelle Intifada sévit dans les
territoires palestiniens. Bien que la violence continue toujours de faire couler
beaucoup de sang dans cette région, qui est probablement le point le plus chaud
de la planète, on constate que l’attention médiatique s’y intéresse de
moins en moins. Toutefois, lorsque le soulèvement éclata et que la couverture
médiatique y fut plus substantielle, l’ambition était-elle de saisir les
causes et enjeux du conflit ou simplement de faire le décompte quotidien des
cadavres ?
Il semble bel et bien que ce soit la deuxième option qui fut préconisée,
alors qu’au 30 décembre 2000 les médias de masse continuaient toujours à
dresser des listes détaillées des défunts : « 304 Palestiniens, un
Allemand, 13 Arabes israéliens et 41 autres Israéliens » (Le
Devoir, 30 déc. 2000). Il s’ensuit ce que nous constatons après trois
mois de sanglants affrontements : une banalisation du conflit. Bientôt
nous n’en parlerons plus, à moins que ce soit pour annoncer une rencontre
quelconque en vue du processus de paix dont, dans les conditions qui prévalent
présentement, l’échec est prévisible.
Comme le soulignait l’écrivaine italienne Oriana Fallaci :
« l’habitude est la plus honteuse maladie parce qu’elle pousse à
accepter n’importe quel malheur, n’importe quelle douleur, n’importe
quelle mort ». C’est exactement ce qui est en train de se produire
présentement Alors que le monde entier était bouleversé, au début
d’octobre, d’être témoin en direct de la mort d’un jeune enfant
palestinien dans les bras de son père ou du lynchage de deux soldats israéliens
à Ramallah, ces morts quotidiennes sont désormais devenues des banalités. Et
comme aucun grand média n’a pris le temps de cerner tous les contours de ce
conflit qui perdure depuis trop longtemps déjà, les gens ne comprennent pas
pourquoi sévit toujours celui-ci et, logiquement, s’en désintéresse
graduellement.
En attente de la paix
Un élément important qui peut contribuer à l’incompréhension et au
désintéressement des gens est le fait que depuis la signature des accords d’Oslo,
le 13 septembre 1993, à Washington, nous entendons continuellement parler
d’espoir et de perspectives de paix au Proche-Orient. Ceci étant pratiquement
tout ce qui ressort des grands médias lorsqu’il est question de cette région,
il est normal que quiconque ne s’étant pas penché sur le contenu de ces
accords ou sur les événements ayant eu lieu depuis près d’un siècle ne
puisse comprendre pourquoi la région est à feu et à sang et non pas en train
de construire la paix.
Alors que le discours dominant soutient que ces accords constituent le
chemin qui conduira à la paix, il semble que la réalité ne soit pas si rose.
Comme le soutient l’écrivain palestinien Edward W. Said, Oslo ne constitue
point un pas vers la paix, mais un acte de reddition du peuple palestinien qui
porte en lui le risque d’une perpétuelle soumission. Mise à part la
reconnaissance de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), les
Palestiniens n’ont pas obtenu de grandes garanties quant à la constitution
d’un futur État palestinien viable. Comme le faisait remarquer Alain Gresh :
« les questions les plus épineuses
- le statut de Jérusalem, la définition des frontières, l’avenir des
colonies, le sort des réfugiés, la création d’un État palestinien -
seraient laissées en suspens en attendant l’accord final » (Manière
de voir 54, nov-déc 2000, p.14). Aussi, il est facile d’extrapoler les
conséquences des clauses portant sur une coopération économique entre l’Autorité
palestinienne et l’État d’Israël, alors que « l’économie
des territoires occupés dépend à 80% de l’État hébreu » (Manière
de voir 54, nov-déc 2000, p.12).
Une autre perception qui biaise la vision du conflit est le fait que les
différents médias semblent se complaire à louanger les différents acteurs du
processus de paix - surtout les dirigeants israéliens et américains, les
dirigeants palestiniens étant souvent désignés comme les responsables des échecs
des divers sommets pour la paix. Par exemple, l’ex-premier ministre israélien
Itzhak Rabin, assassiné par un extrémiste juif en 1995 et l’un des
principaux acteurs des accords d’Oslo, est souvent perçu comme « l’homme
de la paix » au Proche-Orient. Toutefois, a-t-on déjà souligné qu’après
la signature de ces accords, il poursuivit à grands frais la colonisation dans
les territoires occupés, comme en témoigne le projet de son gouvernement, en
1995, en coopération avec le conseil municipal de la colonie de Maale Adumim,
pour l’extension de celle-ci ? Sur ce, a-t-on déjà mentionné que cette
politique coloniale s’est poursuivie depuis lors sous l’égide des
gouvernements de Shimon Pérès - autre acteur des accords d’Oslo - Benyamin
Netanyahou et Ehoud Barak, ce dernier la poursuivant même alors que se déroulait
les négociations de Camp David l’été dernier ? A-t-on déjà aussi
mentionné que les colons bénéficient d’une foule d’avantages pour inciter à
la colonisation et que les colonies israéliennes sont érigées selon une
optique qui semble très loin de la paix, le docteur en géopolitique Frédéric
Encel caractérisant même de « forteresses civiles » les quartiers
juifs de Jérusalem-Est ? Et dans tout ce contexte, a-t-on déjà souligné
la partialité évidente du géant américain pour Israël dans la région,
partialité connue par la communauté internationale depuis la création de l’État
hébreu, en 1948 ?
En s’en tenant donc trop fréquemment aux simples
dirigeants, les grands médias oublient trop souvent que dans les deux camps, il
y a des femmes et des hommes qui recherchent une paix véritable basée sur la
reconnaissance mutuelle des deux peuples. En effet, il est très rare que les médias
de masse s’adonnent à tâter le pouls de la population sur le terrain. Nous y
verrions qu’en Israël, la majeure partie de la population aspire à la paix
et s’éloigne toujours plus des doctrines sionistes qui dominent l’agenda
politique israélien. Du côté palestinien, nous y verrions une société où
les vrais démocrates sont beaucoup plus nombreux qu’on ne pourrait le croire,
les Palestiniens ayant quand même réussi à ériger six universités malgré
l’occupation israélienne.
La réalité de cette partie du monde, où sévit une
profonde injustice reconnue par la communauté internationale, est donc beaucoup
plus complexe qu’elle ne l’est présentée. Toutefois, cette injustice ne
saura arriver à son terme tant et aussi longtemps que de nouvelles bases
de discussion ne seront pas établies pour en arriver à une paix juste et équitable.
Sinon, même si les journaux et la télévision continuent d’annoncer un
espoir de paix dans le conflit israélo-palestinien, les pierres des
Palestiniens continueront à faire face à l’imposante force militaire
israélienne.
Pour en savoir davantage
sur le conflit lui-même, quelques suggestions :
CORN, George. Le
Proche-Orient éclaté, 1956-2000.
Paris, Gallimard, 1999, 1068 pages.
ENCEL, Frédéric. Géopolitique
de Jérusalem. France, Flammarion, 1998, 282 pages.
Le
Courrier International, 13
au 19 juillet 2000,
p. 32-37.
Le
Courrier International, 7 au
13 décembre 2000, p.46-55.
Manière
de voir, no. 54, nov-déc
2000 : contient de nombreux liens de sites Internet
Haut de la page
Index - Le
Monde