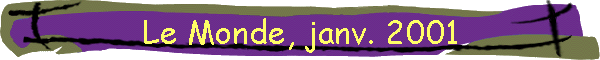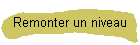
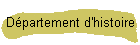
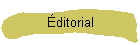
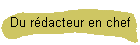
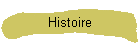
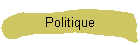
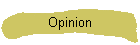
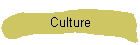
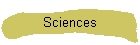

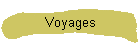
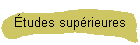
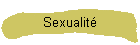
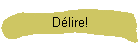
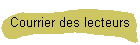

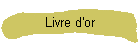 | |
L’usage du monde
Par Dimitri Latulippe
maridimi@sympatico.ca
15 mars 2000
C'est tout de même surprenant de
constater comme le mot voyage peut être relatif. Pour les Occidentaux
bourgeois-consommateurs que nous sommes, l’allusion à ce mot est souvent
source d’exotisme, de libération, de rêverie... Mais, entre nous,
reconnaissons aujourd’hui la dualité contextuelle du terme qui nous oblige à
distinguer la nature antagonique du voyage : l’exode.
La tête embrassant méthodiquement
l’harmonie chaotique du train, je défile depuis maintenant quatorze heures en
direction d’Alma Ata au Kazakhstan (à ne pas confondre avec Alma, Lac St-Jean
!). Déambulant lentement dans l’inépuisable steppe, bercé par le rythme hésitant
mais certainement répétitif du train, je consomme l’insouciance du nomade.
Depuis l’embarquement à Tachkent, je tente sans grand succès d’éviter le
regard insistant de mes compagnons de cabine. Il faut savoir qu’un étranger
parmi la populace, parmi la masse d’errants quotidiens, parmi cette
interminable chaîne de gens qui vont du point A au point B, c’est un cadeau
venu du ciel pour ces Asiatiques. En mal de divertissement, la dissection
interrogative devient rapidement une tradition éphémère dans ces trains
avares de métissage ethnique. Dès le départ, j’avais constaté que nous étions
bien sept dans un compartiment habituellement réservé à quatre personnes,
mais j’avais arraisonné rapidement ce questionnement qui habituellement ne mène
nul part. Il faut savoir que la cohérence est une donnée rarissime dans ces
contrées lointaines. L’aberration est ici aussi courante et grouillante que
les Mcdos chez nous. Subjugué par mes élucubrations intarissables, je
n’avais pas particulièrement porté attention à mes compagnons du moment.
Survint alors le point de contact que nous cherchions, l’un et l’autre,
depuis le début, lorsque le train s’immobilisa aux abords de la magnifique
ville de Shymkent (magnifique est ici utilisé avec une ironie bien appuyée en
raison de la nature hideuse de l’esthétique soviétique !). La mère de cette
jolie maisonnée me demanda soudain, dans le langage le plus international qui
soit :
-Tachkent ? - le doigt pointé vers l’extérieur.
Et moi de répondre :
-Niet, Shymkent. Faisant mon fier dans un russe plus que précaire, et surtout
en ignorant totalement la nature interrogative de son air, une fois mon épineuse
phrase récitée. Je compris rapidement que cette femme ne parlait pas plus
russe que moi. À travers les sacs monstrueux, les ailes de poulet à moitié
rongées et les croquettes de pâte à saveur de viande qu’ils trimbalaient,
je n’avais pas remarqué que cette famille n’était pas russe, ni
d’ancienne allégeance soviétique d’ailleurs. Après une conversation schématique
(au sens propre du terme), j’appris que ces gens étaient afghans, qu’ils
quittaient leur pays parce que l’électricité y fonctionne que quelques
heures par jour et que la plupart des membres de leur famille ont été hachés
menu par une rébellion interminable. La dureté de leur parole et la froideur
prosaïque de leur discours me fit relativiser sommairement les faits puisque,
après tout, chez nous aussi, des gens meurent tous les jours à la T.V. , dans
les vues et lors de la crise du verglas. Qu’est-ce qu’ils ont de plus que
nous à se plaindre ? J’appris ensuite qu’ils se dirigeaient vers la Russie,
vers Novosibirsk, « grande capitale de la Sibérie Occidentale », où
ils ne connaissaient personne et où personne ne les connaissait, pour trouver
un refuge et un toit dans cette grande démocratie qu’est devenue la Russie.
Ne sachant pas où était réellement cet endroit paradisiaque, ils décidèrent
de prendre le train et de chevaucher à travers les steppes tartares les
milliers de kilomètres les séparant de l’eldorado mythique. Exilés d’une
patrie qui les répudiait, ils demeuraient ambivalents quant au sort qui les
attendait. Espérant un retour éventuel, mais également désirant sentir et
profiter du capitalisme occidental, ils partaient sans rien sauf ces trois
enfants, difficilement arrachés aux Talibans. Le père, dans une surprenante
envolée locutrice, me fit alors part que son frère avait quant à lui gagné
le gros lot: installé dans la magnifique ville de Calgary (« magnifique »
est ici employé selon la même formule que précédemment), il travaillait pour
une firme de confection d’habit. Se plaisant manifestement à l’imaginer
riche et célèbre (peut-être que c’est lui Hugo Boss après tout !), mon
petit monsieur m’avoua par la suite n’avoir pas eu de nouvelles de son
frangin depuis des lustres.
-Shymkent, ma p’tite madame, c’est au Kazakhstan. Et malgré ce que ces gens
peuvent bien prétendre, le Kazakhstan, c’est loin de l’Europe, c¹est loin
de l’Amérique, c’est loin du monde...
Le Kazakhstan. Pays des Kazakhs, êtres
mythiques descendant directement du grand Genghis Khan. Territoire vaste, semi-désertique,
centre de l’Asie, centre du monde. Contrairement à certains peuples, les
Kazakhs se sont rarement considérés comme les détenteurs de ce centre du
monde. Peuple humble, peuple fuyant, peuple nomade, ces chevaliers ont dû,
malgré eux, laisser les Russes déployer leur immense machine annihilante.
Ayant ainsi perdu l’usage de leur monde, ils ont dû avec le temps et la répression
devenir des vassaux, des torturés, des esclaves de leur grand voisin
omnipotent. Le Kazakh d’aujourd’hui est essentiellement un compromis entre
la steppe, la ville et l’assujettissement soviétique. Résolument tourné
vers son ancien bourreau, le Kazakhstan est probablement la plus russe des
anciennes Républiques socialistes soviétiques.
Décidée à s’accommoder
l’intelligentsia capitaliste de notre belle planète (lire ici, rapace,
charognard ou harpagon, à vous le choix), la nouvelle bureaucratie en place
gouverne en fonction de l’exploitation systématique de ses ressources,
naturelles et humaines. Ainsi, le réveil national relevé chez les Ouzbeks
n’a ici jamais eu lieu. Les instances politiques restent majoritairement dominées
par les Russes, population minoritaire mais opportuniste. Cette aliénation
culturelle reste le facteur absolu de la stagnation intellectuelle du peuple
kazakh. Dernier à déclarer son indépendance à la suite de la chute du régime
communiste, le Kazakhstan fut la première des anciennes colonies soviétiques
à proposer l’instauration de la C.E.I. pour maintenir la relation idéologique
avec le dinosaure communiste. Ignorant la variable nationale, les dirigeants ont
toujours utilisé le nationalisme à des fins politiques plus que patriotiques.
L’hypocrite stabilité et l’artificielle égalité politique reposent sur
les épaules d’un seul homme, ancien apparatchik du parti, qui a su jouer les
recours légaux qu’offrent les constitutions démocratiques pour se donner les
pleins pouvoirs. Comme en Ouzbékistan, ce président trône sur une assemblée
ridicule, inutile et inoffensive qui ne trouve aucun écho dans une hypothétique
contestation. Les anciens soviétiques sont difficilement portés vers la
dissidence, merci à M. Staline ! Maintenu en poste, possédant la légitimité
falsifiée d’un taux de satisfaction de 90%, M. Nazarbaev utilise ses prérogatives
pour imposer ses vues décadentes sur le futur de l’État. Selon le despote,
le Kazakhstan devrait atteindre le niveau des pays les plus industrialisés
d’ici 2030, utilisant des plans quinquennaux (tiens, j’ai déjà lu ça
quelque part !) pour y arriver. Bien sûr, le bon père du peuple devra demeurer
en poste pour qu’un tel objectif soit atteint. On se demande vraiment, avec
une pointe de sarcasme, chez les Kazakhs, comment il pourrait bien arriver à réaliser
ne serait-ce que la pointe de son mirage. Le travail est presque inexistant, la
pauvreté est en nette croissance et l’exode des intellectuels russes et
allemands ne cesse d’augmenter depuis 1991. L’exploitation sauvage de la
Caspienne et la vente de parcelles de steppe à l’étranger ne pourront guère
influencer la tangente globale de la situation.
Les villes sont désormais abandonnées à
leur décrépitude : l’ère soviétique a dénaturé le paysage à un point
tel qu’on commence à déserter ces cités qui n’avaient de raison d’être
que dans l’absurdité communiste. Aralsk, sur la mer d’Aral, est désormais
complètement fantôme, les installations autour de la base spatiale Baykonur
sont délaissées par une Russie en manque d’argent, sans parler des terres
autrefois exploitées par Khrouchtchev sous son programme de revitalisation de
la steppe, qui sont à toutes fins pratiques aussi arides que le Gobi. Les
nomades sont sédentarisés, Alma-Ata est internationalisée et le pays est désolé.
À cheval entre le désir et la réalité, le Kazakhstan attend la suite. Prête
à changer, mais consciente de ses racines oubliées, la population est
ambivalente. Modernité et lassitude se côtoient ; Leonardo Dicaprio
affiché sur un centre commercial dissimule le gris de la matérialité soviétique.
Fait le plus remarquable, la population reste souriante et avenante. Naïve ou désintéressée,
elle demeure tout le moins vivante. Elle se cherche, mais avec bonhomie. Comme
ses frères d’Asie centrale, le Kazakhstan est en quête d’une identité
propre. Moins islamique que ses voisins, plus russe peut-être malgré lui, le
pays reste fondamentalement nomade, errant à la recherche d¹une histoire
sociale fabuleuse que l’immensité de la steppe tarde à livrer.
10 mai 2000
En quittant cette immensité de néant
qu’est le Kazakhstan, j’ai repensé à mes amis afghans. Sans s’en
apercevoir, ils sont passés à travers une réalité résolument semblable à
leur espérance. Si trente heures de train ne leur ont pas fait réaliser la
nature géographique de leur situation, les vingt-cinq minutes compilées, ici
et là, avec ces Kazakhs sur les trottoirs de gares ont peut-être permis à
cette famille de comprendre. Que leur Russie escomptée était bien loin de
Kaboul, qu’Alma Ata aurait été une bonne étape pour reconsidérer leur
voyage. Que l’on cherche partout notre parcelle de terre bien à nous, et
qu’il faut bien se rendre à l’évidence, ce carré d’identité est
rarement chez l’autre. Peut-être que la famille a décidé de rentrer. Désorientés,
ils sont peut-être allés vers l’ouest, vers l’est, pour perpétuellement
chercher leur chemin de retour. Ou peut-être qu’ils se sont rendus à
destination et que, malgré ce que je peux bien raconter, ils ont réussi à
concrétiser leur propre usage du monde.
Haut de la page
Index - Le Monde |