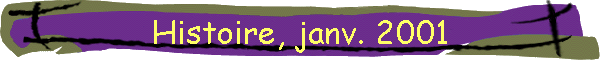Égalité
ou Indépendance : l’idée de Johnson
Par Stéphanie
Charland
Stef_Charland@hotmail.com
Daniel Johnson
est un battant, il a lutté toute sa vie pour arriver jusqu’au poste de
Premier ministre. Né le 9 avril 1915 à Danville, en Estrie, d’un père
irlandais et d’une mère canadienne-française, Johnson est d’origine
modeste, son père ayant dû occuper plus d’un emploi pour nourrir sa famille
de huit enfants (Daniel est l’aîné). Il a été commis de quincaillerie,
vendeur d’assurances et de machines à laver, assistant-gérant d’un magasin
de la Commission des Liqueurs du Québec. Il a perdu ce dernier emploi à cause
de son allégeance au Parti conservateur. Il a été congédié lors du retour
des Libéraux en 1939. Daniel Johnson a pu aller au séminaire de Saint-Hyacinthe grâce
à l’aide d’une veuve héritière. Il voulait à l’époque devenir prêtre.
Ses sermons contenaient des éléments politiques, au grand dam de ses
professeurs. En 1937, il décida de laisser tomber la soutane et entra au
barreau. Maurice Duplessis était le bâtonnier général de la province à l’époque.
Ce fut le premier contact entre le Chef et son futur protégé. Il présida l’Association
générale des étudiants. Il collabora au journal de l’association étudiante
(Le Quartier latin). Il œuvra dans des mouvements confessionnels
tels, Pax Romana, Fédération
des étudiants catholiques, et l’Union
de la jeunesse catholique du Canada.
L’année 1948 marqua
le début de sa carrière politique. Il sera élu dans Bagot jusqu’à la fin
de sa vie, cette ville étant le lieu où se situait son bureau d’avocat. En
1950, l’Assemblée législative lui paya un voyage en Océanie à l’occasion
de la Conférence des parlementaires du Commonwealth britannique. Il sera élu
directeur à titre de représentant des provinces canadiennes. En 1952, il sera
nommé président alors que la même conférence se déroule au Canada. Le 11
janvier 1953, son épouse fut la cible d’un attentant, rue Dorchester, à
Montréal. Le lendemain Johnson offre sa démission, Duplessis la
refusa. La même année, le Chef le nomme secrétaire parlementaire. En 1955, il
assume la fonction de vice-président de l’Assemblée législative. Johnson,
en attente d’un ministère, prend en main la campagne électorale des
conservateurs fédéraux.
C’est en 1958
que Johnson acquière le ministère des Ressources hydrauliques. À cette époque,
ce ministère n’était qu’à l’état embryonnaire. À ce moment, Hydro-Québec,
la nouvelle société d’État, projette de construire une deuxième centrale
à Bersimis, de développer la centrale de Beauharnois et d’ériger de
nouvelles stations et de nouvelles lignes de transmission. De plus, l’aménagement
de la Manicouagan est à l’étude. Duplessis
préconisait pour la Manicouagan des ingénieurs américains. Johnson conteste
la décision du Chef et offre les postes à des Canadiens-français. Johnson a
été impliqué dans le scandale du gaz naturel, une histoire de spéculation
qui ne lui rapportait que 5250 $.
En 1959, le Chef
meurt, suivi de Sauvé en 1960 et, avec la défaite de Barette lors des élections,
il y a une course à la chefferie du parti de l’Union nationale en 1961,
opposant Johnson et Bertrand. Johnson était mal aimé des politiciens, mais la
population l’adorait. En effet, Johnson avait ce regard pénétrant, isolant
son interlocuteur. De plus, il avait la mémoire des noms. Il devient alors chef
de l’opposition officielle face à Lesage. En 1962, le premier débat télévisé
a lieu au Québec. C’est Lesage qui remporte le débat par sa plus grande préparation.
Pendant le prochain mandat, Johnson joue un rôle efficace dans l’opposition.
En 1965, Johnson publie un livre, Égalité
ou Indépendance. Dans celui-ci, Johnson revendique « l’égalité
des minorités francophones du Canada comme pour la minorité anglophone du Québec,
le droit à l’autodétermination des Québécois, leur droit à s’épanouir
normalement selon leur entité ethnique et culturelle distincte, dans un cadre
juridique politique et institutionnel clairement défini, la reconnaissance
effective des canadiens français comme l’un des deux peuples fondateurs du
Canada et du statut particulier qui en découle pour le Québec, leur foyer
national, la reconnaissance élargie du français comme l’une des deux langues
officielles ». Il est le premier à avoir une vision d’un fédéralisme
renouvelé. Il fut le premier chef d’un parti politique reconnu à tenir
compte de l’option indépendantiste. C’était cependant une mesure extrême.
En 1966, lors de la campagne électorale, les sondages donnaient la
victoire aux libéraux avec Lesage. Mais, la révolution tranquille n’avait
pas fait que des satisfaits. La hausse des taxes et la réforme scolaire
choquaient. Quant à Johnson, il a
dû employer tout son temps à faire
des apparitions publiques, des discours et du
porte à porte, car la caisse électorale du Parti était vide. Il fit
une entente avec le chef du Ralliement pour l’indépendance nationale. En
1966, Johnson est élu. Il obtient 55 comtés avec seulement 41% du vote et les
libéraux 51comtés avec 47% du vote. Pendant son mandat de deux ans, Johnson
accomplit certaines grandes choses.
Il crée l’Université
du Québec, Radio-Québec, les cégeps, la Commission d’études Dorion sur les
frontières du Labrador et la Société d’habitation du Québec. Le
gouvernement de Johnson est en guerre froide avec Ottawa sur le plan
constitutionnel. Ottawa refuse que le Québec soit représenté comme entité
distincte dans des réunions internationales sur des sujets relevant
exclusivement de la compétence des provinces. Lors de l’Exposition 67, le Québec
n’est pas décrit par le Premier ministre comme étant une simple province,
mais plutôt comme une entité distincte. En mai 1967, Johnson se rend en voyage
officiel en France, ce qui déplaît au fédéral. Le sommet de la crise entre
Ottawa et le Québec survient en 1967 lors de la visite du Général Charles de
Gaulle au Québec. Il cria le fameux : « Vive le Québec libre »,
qui fut transcrit par les téléscripteurs sur les cinq continents. Ce cri a mis
dans l’embarras la France, qui ne voulait pas assumer cette déclaration. Mais
c’est Ottawa qui en est le plus insulté. En plus, Charles de Gaulle retourne
en France sans passer par Ottawa comme il était prévu. Cet événement est
l’un des plus marquants dans la carrière du Premier ministre.
Le 25 septembre
1968, il fait une conférence où il se montre comme le véritable chef de tous
les Canadiens francophones. Malgré les nombreuses attaques cardiaques qu’il a
subies, Johnson poursuit « sa mission ». Il est entouré de médecins
depuis le début de son mandat. Il déclare : je
m’en vais mourir debout, cette semaine. Le lendemain, il se rend à Manic
Cinq pour l’inauguration du plus grand barrage à voûtes multiples et
contreforts au monde. Cette mise en chantier s’était produite sous son ministère.
Le matin du 26, il est retrouvé mort dans son lit.
Daniel Johnson a obtenu ses victoires politiques avec acharnement et
travail. Comme plusieurs bons politiciens, il est mal aimé par ses pairs. Mais,
la population a su reconnaître son travail et ses idéaux. Le mandat de Johnson
est inachevé par sa mort. Il lègue en héritage ses idées. Ses deux fils,
Daniel et Pierre-Marc, ont chacun retenu un élément de leur père. Pierre-Marc,
Premier ministre en 1985 dans le Parti québécois, crie à l’indépendance.
Tandis que Daniel (fils), chef du Parti libéral du Québec en 1994, invoque
l’égalité. Alors « l’égalité ou l’indépendance » que déclarait
Daniel Johnson en 1965 sont des réalités que le Québec cherche toujours à défendre.
Haut
de la page
Index - Histoire