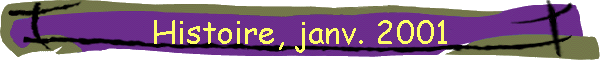
|
|
|
Démocratie
et féminisme en Islande : des
origines à la décennie de 1980
Par
Marc-André Durand
Après avoir peuplé
une petite île glacée de l’Atlantique Nord, un groupe de Vikings décida de
vivre sous une loi commune. Les chefs ainsi que leurs tributs se réunissaient
chaque année pour légiférer. Ces réunions sont à l’origine de l’Althing
islandais qui, dès 930 après J.-C., forme l’ancêtre de tous les
parlements. Deux semaines par été, les Vikings y achetaient et y vendaient des
esclaves, racontaient leurs aventures et rendaient justice. Une partie des lois
du commonwealth d’Islande étaient lues publiquement par un orateur et en un
cycle de trois ans, on avait lu tout le corpus. Jusqu’en 1280, la loi n’était
pas publiée.
Une des premières lois de l’Althing
spécifiait que chaque Islandais devait être baptisé comme chrétien. Le
Thingvellir étant toujours gelé, les Islandais marchaient une soixantaine de
kilomètres pour aller dans les sources chaudes, entre autres pour les baptêmes.
Aujourd’hui, les sources thermales sont toujours un lieu de discussion sur la
démocratie pour les 200 000 habitants. Chaque matin de Reykjavik, la capitale,
les politiciens, les plombiers, les ménagères, et autres se rassemblent pour
former la tradition d’échanges et de discussions politiques. Patrick Watson
rapporte que «les Islandais affirment qu’ils peuvent, en une heure de
discussion, régler tous les problèmes du monde! »
La démocratie islandaise a l’immense avantage de prévenir
la corruption; chaque citoyen pouvant réellement prendre part à la vie
politique. Comme en Suisse, la petitesse géographique et démographique du pays
joue un rôle important dans le processus législatif.
Mais même par rapport à la Suisse, l’Islande est
minuscule. Ceci tend à prouver que la démocratie est affaire de groupuscule.
Son parlement, nous l’avons dit, date de 930 de notre ère, soit avant la confédération
helvétique. Mais même le plus ancien parlement du monde resterait jusqu’à récemment
phallocrate. Bien que parmi les premiers pays à accorder le droit de vote aux
femmes, le «sexe faible » restait mineur sur le plan politique. En 1970,
l’Islande n’avait que quatre avocates. En plus d’une relative misogynie,
l’Islande comme la Suisse fait face à un nouveau problème : adapter la
vie politique à la notion moderne de citoyen tout en restant une démocratie
participative. Les Islandais comme les Suisses sont de moins en moins intéressés
par la politique. Le développement du féminisme amena une solution : les
Islandaises s’intéressèrent, elles, à la démocratie et à la politique. Et
elles le firent savoir. En 1975, année internationale de la femme, toutes les
Islandaises firent la grève. Le pays fut paralysé.
Le féminisme islandais avait ceci de particulier :
les femmes ne veulent pas seulement une plus grande place politique, elles
veulent changer les règles du jeu. En 1980, on crée un Parti des femmes dont
trois membres entrent au Parlement, on nomme une femme à la Cour suprême et
Vidgis Finnbogadòttir est élue présidente. Elle devient la première femme au
monde à être élue à la tête d’un État. À propos de son parti, une femme
déclare : «Nous sommes différentes. Notre parti n’a aucune hiérarchie,
il n’a pas de chef; nous travaillons ensemble. Les décisions sont prises par
consensus. »
Bien que la lutte pour le pouvoir soit difficile,
certaines caractéristiques bien islandaises amènent ce consensus :
l’unité raciale, linguistique (le vieux norrois),
religieuse (l’Église évangélique luthérienne) et surtout l’intérêt
pour les compatriotes qui font de la politique. Les Islandaises ne partagent pas
le pouvoir, elles le revoient. Finnbogadòttir féminise la vie politique en lui
apportant des valeurs dites féminines : harmonie, économie domestique,
consensus, etc.
La lutte politique des femmes en Islande a un autre
trait unique : l’attitude presque maternelle de la présidente qui
choquerait plusieurs féministes de d’autres contrées : elle parle de
jardin, de famille, etc. De plus, la tradition économique ancestrale des pêcheurs
a rendu les Islandaises, seules à la maison, très débrouillardes. Dès
l’origine, les hommes Vikings partaient de longs mois et les femmes
s’occupaient des institutions, principalement les institutions bancaires. Dès
la grève de 1975, la différence entre le féminisme local et mondial
s’affirmait : « Les femmes disaient alors : Regardez
combien je suis indispensable ! Non pas : Je veux être présidente !, mais
bien plutôt : Je suis une femme à la maison et mon rôle est important ».
L’Alliance des femmes propose une économie basée sur l’économie
domestique : produire le plus possible à la maison et ajuster les dépenses
en regard du revenu. En 1988, l’Alliance obtient la balance des 63 sièges du
Parlement. Ce parti sans chef utilise le consensus et permet aux non élues de
siéger afin qu’un grand nombre de femmes fassent l’expérience
parlementaire[1]. L’Alliance repousse
toute autorité qui ne découle pas du consensus, même si cela prend plus de
temps. Elle reboute le leadership qui est une affaire d’homme. Les membres de
l’Alliance croient que si elles devaient choisir une Première ministre,
celle-ci, simplement parce qu’elle est une femme, déléguerait ses
responsabilités et serait fort différente d’un homme.
Même les anciennes sagas
montraient des Islandaises fortes et capables. L’Alliance donna un nouveau
sens à la citoyenneté dans un pays où la démocratie participative
s’amenuisait. L’Islande a la chance de n’avoir qu’un seul groupe
ethnique, ce qui permet de canaliser l’énergie politique ne servant pas à la
survie de la cohésion nationale vers la démocratie[2].
L’Islande démontre qu’il n’y a pas de démocratie
si tous les citoyens n’ont pas le pouvoir de gouverner. Le consensus de
citoyens actifs dépasse la formule d’Abraham Lincoln : « Le
bulletin de vote est plus percutant que les coups de fusils. »
Bibliographie
Watson,
Patrick et Benjamin Barber. La lutte pour
la démocratie. Montréal, Québec/Amérique, 1988, pp. 125, 144, 158-161,
167. Boyer,
Régis. « Islande ». Encyclopeadia
Universalis. Paris, Encyclopeadia Universalis (France), vol 12, p. 545-738. Goetschy,
Janine. « Les modèles sociaux nordiques à l’épreuve de l’Europe ».
Notes et études documentaires. No
5001, 1994, p. 1-147.
[1]
Une ancienne loi
permettait aux agriculteurs et aux pêcheurs de laisser provisoirement leurs
sièges. [2]
Avec certains
auteurs de la démocratie, comme Watson, le Canada est cité comme un
exemple de pays qui a tant à faire pour l’unité nationale qu’il ne
peut se diriger vers la démocratie réelle. |