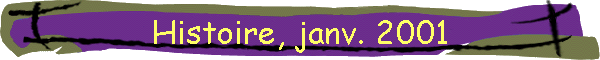"Go back to Europe"
Par Guillaume Teasdale
pointdexter40@hotmail.com
Bonjour chers (ères) historiens et historiennes ! Pour
le temps (et l’espace !) d’un article, je vais laisser de côté mon poste
de rédacteur en chef pour vous parler d’un sujet qui me passionne beaucoup.
Il s’agit des autochtones de l’Amérique du Nord. Les
mythes entourant la colonisation de l’Amérique, tel qu’indiqué dans le
numéro du Sablier, était le sujet initial que je voulais aborder à propos des
Amérindiens. Toutefois, j’ai plutôt opté à vous présenter une perspective
d’ensemble sur la problématique des relations eurocanadiennes-amérindiennes,
des premiers contacts à aujourd’hui. Commençant par survoler le contexte
colonial en Europe, je vais par la suite tenter de tracer pour vous l’évolution,
dans ses grandes lignes, de la situation amérindienne au Canada depuis
l’arrivée de l’homme blanc.
De l’époque classique
à la Renaissance européenne: le mythe du sauvage
Tout d’abord, commençons par définir ce que nous
entendons par «sauvage». Au XVIe siècle, les grandes puissances
coloniales utilisaient ce terme pour désigner un «personnage sans foi, sans
loi, sans roi». Rapidement, l’usage du qualificatif «sauvage» fut attribué
aux Amérindiens à la suite des premières découvertes de notre continent.
Cela s’explique par le fait que les colons ont constaté que les Amérindiens
vivaient dans la nature, ce qui se traduisait, pour un Européen, par une
domination de cette dernière sur son résidant, contrairement à la
civilisation où l’on affirmait avoir le contrôle sur la nature.
L’utilisation du terme « sauvage » fut reçue d’emblée dans le
Nord-Est de l’Amérique, car les populations sur place n’avaient pas de
structures étatiques, ni de lois écrites et qu’ils portaient peu de vêtements
(symbole de pauvreté en Europe).
Néanmoins, il ne faut pas s’y méprendre. Le mythe du «sauvage»
n’est pas né au XVIe siècle en Europe. En effet, déjà à la période
classique en Grèce et à Rome ont parlait de sauvagerie lorsqu’il était
question des peuples éloignés, peu connus ou mythiques. L’imagination jouait
la plupart du temps la plus grande place dans les récits parlant de ces êtres
parfois difformes, gigantesques ou minuscules et fréquemment sanguinaires.
L’Europe, quant à elle, a hérité de ces légendes avec le début du Moyen
Âge, après la chute de l’Empire romain d’Occident en 476. Ayant largement
fermenté durant la période médiévale, le mythe du «sauvage» a repris de
l’ampleur lorsque Christophe Colomb découvrit l’Amérique en 1492 et
qu’il constata que le territoire était habité par des êtres étranges. Dans
un contexte d’humanisme en Europe, de telles trouvailles ne pouvaient demeurer
secrètes bien longtemps et l’image du «sauvage» prenait une nouvelle
tangente. Du fait que l’Amérindien était perçu comme un être sans culture
(non-civilisé), cela entrait ainsi de plein fouet avec une époque humaniste où
l’on tentait de rehausser la qualité de l’esprit par le développement de
la culture.
À quoi se rapportait le mythe lorsque nous pensons aux Amérindiens et
à l’Europe de la Renaissance ? Il était question d’une multitude de légendes
et de ouï-dires qui circulaient à la grandeur de la société du vieux
continent en lien avec les découvertes coloniales au tournant du XVIe
siècle. Pour donner un exemple, une doctrine de l’époque plaçait le monde
autour de Jérusalem. Plus l’on s’éloignait de cette dernière, plus l’on
se rapprochait des races «monstrueuses». Le Nouveau Monde étant considéré
comme l’endroit le plus éloigné de Jérusalem, il était dès lors très
probant d’affirmer que des êtres étranges habitaient ce continent, ce qui
semblait concorder avec les récits des premiers explorateurs de l’Amérique.
À ce sujet, un des faits qui pouvait facilement appuyer un quelconque mythe du
«sauvage» était celui que le cannibalisme était pratiqué sur l’ensemble
du continent. Bien qu’il s’agissait en réalité d’un rite et non d’une
habitude alimentaire, cela ne faisait guère de différence en Europe, les Amérindiens
étaient perçus comme des purs barbares. Cependant, comme nous le verrons plus
loin, cette image effroyable des Peaux-Rouges assoiffés de sang n’a guère
franchi l’étape des contacts superficiels d’exploration (ne pas confondre
avec colonisation).
Il est par ailleurs important de glisser un mot sur les motivations de
l’Europe à mettre en place des expéditions vers l’Ouest. Comme nous le
savons tous, chaque pays explorateur de l’époque cherchait une route vers
l’Orient ou du moins, des richesses. Mais n’y avait-il pas suffisamment de
ressources en Europe pour la subsistance de chacun ? Il semblerait que non. La
fin du Moyen Âge fut marquée par la montée d’une monarchie plus
centralisatrice dans la plupart des royaumes. Ces derniers tendant ainsi à
grossir leur armée, cela a entraîné une hausse substantielle des besoins en
capitaux, d’où la nécessité de trouver de nouvelles sources
d’approvisionnement.
Relations Eurocanadiens-Amérindiens depuis les années 1490
Maintenant, regardons l’évolution
des relations entre Européens et Amérindiens sur le territoire actuel du
Canada. Les tout premiers contacts seraient survenus entre des pêcheurs européens
et des Béothuks de Terre-Neuve, disparus durant le XIXe siècles,
durant la décennie de 1490. Toutefois, nous ne pouvons parler de réelles
rencontres puisque les pêcheurs ne mettaient pied à terre que pour faire sécher
le poisson sur la plage, et cela que de façon occasionnelle. Ce n’est qu’en
1534, avec l’arrivée de Jacques Cartier dans le golfe Saint-Laurent, que des
contacts plus concrets ont eu lieu. Ces derniers surviennent avec des Iroquoiens
(ceux-ci ont disparu entre 1542 et 1580). Dès les premiers échanges, les Européens
se considèrent supérieurs aux Amérindiens, même si les rencontres se sont déroulées
pour la plupart selon les traditions autochtones. Pour des raisons politico-économiques,
les relations entre Cartier et les Iroquoiens ont pris fin abruptement en 1542.
Les contacts Eurocanadiens-Amérindiens suivants n’ont eu lieu qu’au cours
des années 1580 avec le neveu de Cartier, Jacques Noël. Cependant, l’établissement
d’Européens (français) au «Québec» n’a débuté définitivement qu’en
1608 avec la fondation de la ville de Québec par Samuel de Champlain. Sans
entrer dans les détails de colonisation, c’est à partir de ce moment que je
vais vous dresser un éventail des contacts.
De quelle façon les Eurocanadiens ont-ils exploité leurs relations avec
les Amérindiens ? Dans un premier temps, autant pour les Français occupant une
partie du Québec actuel que pour les Anglais plus au sud, les Amérindiens,
selon les tribus, sont devenus des alliés de l’une ou l’autre des deux
puissances (à quelques exceptions près). Ce qui a eu des répercussions
importantes pour les Amérindiens, car cela a fait en sorte de diminuer leur
population à cause de la montée des conflits militaires, mais également, à
cause des épidémies. Cette situation caractérise principalement le XVIIe
et le XVIIIe siècle, où les Amérindiens ont été beaucoup plus
affaiblis que les colons. Dans un second temps, un commerce des fourrures, à
l’avantage des Européens, a pris de l’expansion (et est aussi devenu une
source potentielle de litige entre les nations autochtones). Dans un dernier
temps, les Amérindiens ont fait l’objet de tentatives de christianisation;
d’abord par les Récollets et peu après, par les Jésuites. Cette situation a
mené à la création de réserves dès le XVIIe siècle. Nous
n’avons qu’à penser à la réserve de Sillery (1638), composée surtout de
Montagnais (culture algique). Kahnawake (1716), Oka (1721), Kanesatake et
Akwesasne (durant la même période) sont également des réserves issues du
mouvement évangélique des Jésuites, à l’exception que ces dernières sont
composées essentiellement de Mowaks (culture iroquoise). Avec ce mécanisme
d’évangélisation, Alain Beaulieu, professeur d’histoire à l’UQAM,
mentionne :«En s’attaquant aux pratiques et aux conceptions religieuses
traditionnelles, les Jésuites frappent au coeur de l’identité amérindienne».
Dans un cadre politique, l’évolution des relations entre Blancs et Amérindiens
a suivi un parcours semblable. En 1791, le «Canada» établissait son premier
Parlement en n’accordant aucun droit démocratique aux Amérindiens. Près
d’un siècle après, en 1857 (époque du Canada-Uni), une loi fut votée pour
«émanciper» les Amérindiens, c’est-à-dire ne plus les laisser en marge de
la société, ou plutôt les assimiler. En 1869, la Loi sur les Amérindiens
accorde pour la première fois un statut distinct aux autochtones reconnus comme
Premières Nations. Or, en 1880, on a tenté à nouveau de rendre les Amérindiens
plus «blancs» par l’Acte des «sauvages». Ce dernier a été remplacé en
1951 par la Loi sur les Indiens, même si l’idée est demeurée identique.
Trudeau et son gouvernement ont suggéré l’abolition du statut amérindien en
1969 avec la présentation du Livre blanc
mais l’idée fut abandonnée à la suite des protestations des Amérindiens
dont le point culminant fut la sortie, en réponse, d’un Livre
rouge. En 1982, dans le contexte du rapatriement de la constitution par
Trudeau, le désir «d’émanciper» les Amérindiens a été définitivement
abandonné avec l’adoption de la Nouvelle Loi sur les Indiens. Nous pourrions
croire que cette saga politique a pris fin en 1985 avec la loi C-31, qui
redonnait le statut d’Indien à quelques milliers d’autochtones, mais ce ne
fut pas le cas. Malgré le fait que la question amérindienne n’a pas occupé
une grande place lors de la dernière campagne électorale canadienne, Stockwell
Day et son parti, l’Alliance canadienne, ont manifesté l’intention
d’enlever ce statut distinct aux autochtones dans l’intention, selon eux,
d’en faire de «vrais» Canadiens.
Donc, si nous regardons l’évolution des rapports entre Eurocanadiens
et Amérindiens, nous sommes en mesure de constater que les problèmes de l’ère
coloniale n’ont pas disparu, mais qu’ils se sont plutôt transformés. De
choc culturel et d’incompréhension, le litige est devenu plus politisé avec
le temps. Un bon exemple qui nous a démontré, de par sa violence, que les Amérindiens
(sans toutefois généraliser) souffraient toujours du trouble causé par
l’impact de la colonisation est la crise d’Oka en 1990. Malgré le fait que
cet événement est un exemple montrant que la problématique des relations
colonisateurs-colonisés n’est pas réglée, il en est un parmi tant
d’autres. À propos d’un triste événement découlant du conflit opposant
les warriors à la «société québécoise»,
Pierre Trudel, professeur d’anthropologie au Cégep du Vieux-Montréal,
commente ainsi :«Go back to Europe
est probablement l’une des dernières phrases que le caporal Lemay a entendues
le matin du 11 juillet 1990 à Oka», ce dernier qui a été assassiné dans des
circonstances obscures.
Haut de la page
Index - Histoire