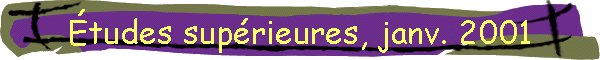
|
|
|
Quelques conseils pour survivre à la maîtrisePar Éric Fournier histoire, 2e cycle Bonjour à tous et à toutes, je suis Éric Fournier, étudiant du 2e cycle, présentement en rédaction en histoire romaine, sous la supervision de Mme Hélène Leclerc et la codirection de Mme Élizabeth DePalma Digeser (McGill). Quelques-uns d’entre vous ont déjà eu l’occasion (je n’ose dire «la chance», cela dépend évidemment du point de vue!) de me côtoyer dans le cadre du cours d’Introduction à l’histoire de l’Antiquité (au risque de rappeler des mauvais souvenirs à certains…). Je souhaite tout d’abord profiter de l’occasion qui m’est présentement offerte pour me joindre à tous les «mon oncle» et «ma tante» du Québec et vous souhaiter à tous et à toutes, «ben du succès dans vos études»! Et que ce [véritable] nouveau millénaire soit à la hauteur de vos espérances! Soit, trêve d’ironie… Venons-en donc au fait qui me concerne aujourd’hui. Marchant dans les traces de deux de mes «collègues-apprenti-chercheurs», je tenterai de contribuer à mieux vous familiariser avec le merveilleux monde des cycles supérieurs en vous parlant de mon expérience et de mon projet de recherche actuel[1]. Le titre choisi pour mon mémoire est : «Les résidences impériales de l’Occident romain tardif (3e-5e siècle) : reflet du transfert de l’axe méditerranéen vers l’axe rhéno-danubien?». En français, cela signifie que, de façon générale, mon objet d’étude est le phénomène de la décapitalisation de Rome, l’abandon de la Ville éternelle comme capitale politique de l’Empire pour d’autres villes européennes. Trois de ces villes sont prises comme «cas» d’études : Mediolanum (Milan), Sirmium (l’actuelle Sremska Mitrovica, en Serbie) et Augusta Treverorum (Trèves, en Allemagne). La première caractéristique qui saute aux yeux, dans l’étude de ce phénomène, est le déplacement des centres politiques vers le front militaire, la frontière naturelle que constituaient le Rhin et le Danube. D’où la seconde partie du titre, où je pose la question à savoir si ce déplacement peut avoir été suffisamment important pour modifier l’axe vital de l’Empire romain tardif. Les limites chronologiques de mon étude sont d’une part, 284 avec l’avènement de Dioclétien et la mise en place de la Tétrarchie, régime politique à quatre empereurs, d’autre part le déménagement de la cour impériale de Milan à Ravenne, en 402/403, conséquence des invasions germaniques qui menacent l’Italie du Nord et qui mèneront à la prise de Rome par Alaric en 410. De façon très simplifiée, voire simpliste, on pourrait dire que l’Empire romain en est arrivé à la situation suivante : une ville est parvenue à conquérir l’ensemble du bassin méditerranéen, mais l’évolution historique de plus de dix siècles a mené à cette apparente contradiction qui voit les militaires issus des provinces les plus militarisées (surtout les Illyriens) dominer la scène politique et gouverner l’Empire d’une ville qui n’est plus la capitale effective de son propre empire! Que voulez-vous, l’histoire a parfois ses caprices et sa propre logique… Voilà, de façon très sommaire, mon objet d’étude, dont je pourrai vous parler encore [trop!] longtemps. Aussi, mon mémoire s’attache plus précisément à démontrer l’impact de la présence impériale dans ces trois régions, dans trois secteurs principaux : l’économie (les ateliers monétaires impériaux de chaque ville), la société (la cour impériale comme lieu de mobilité sociale) et la religion (l’impact de la présence impériale sur les querelles doctrinales chrétiennes et en particulier les conciles régionaux). J’ai découvert ce sujet il y a déjà quatre ans, en faisant un travail de session pour un cours d’histoire romaine de 2e année (des Antonins à l’Empire tardif, donné par Hélène Leclerc). J’avais alors étudié le transfert de la résidence impériale de Milan à Ravenne en 402/3 (le terminus ante quem de mon sujet de mémoire). Intrigué par ce sujet, j’étais parvenu à faire un travail respectable (que je réécrirais en entier aujourd’hui, mais bon…) et Mme Leclerc m’avait offert de le «publier» dans un numéro spécial étudiant de la Revue de la Société des Études anciennes du Québec. Ce fut le coup d’envoi d’une étude que je compte poursuivre encore plus loin, puisque je prévois m’inscrire au 3e cycle en septembre prochain et conserver ce sujet en l’élargissant à d’autres lieux de résidence. D’où l’importance de bien choisir les sujets de vos travaux! Car nul ne sait ce que l’avenir vous réserve. Ce qui m’amène à parler de la vie du 2e cycle. Personnellement, ce que j’ai trouvé le plus difficile, dans la transition, est le changement drastique que cela occasionne au niveau social. Habitué à suivre des cours où le nombre d’étudiants est beaucoup plus élevé, il n’est pas rare, dans les séminaires de maîtrise, de suivre un cours où il n’y a que deux étudiants avec le professeur! Imaginez-vous lorsqu’un des deux est malade et que le professeur est en retard… On est donc pratiquement laissé à soi-même, ce qui n’est parfois pas évident. Cela vaut pour la première année, durant la scolarité, mais c’est encore pire durant les mois de rédaction, où on est constamment en tête-à-tête avec ses bouquins et son écran d’ordinateur. D’après moi, c’est l’aspect le plus caractéristique des études supérieures, et à tous ceux et celles qui hésitent encore à savoir s’ils doivent poursuivre ou non après avoir terminé leur baccalauréat, réfléchissez surtout à cela : parviendrez-vous à être assez discipliné pour éliminer les distractions inutiles qui vous entourent et vous concentrer sur un travail solitaire durant plus d’un an? D’où l’importance, de conserver le plus possible des liens avec les autres étudiants qui vivent le même cheminement. Un professeur ontarien diplômé d’Oxford m’a dit un jour qu’il avait beaucoup appris en allant à cette Université reconnue, non pas tant à cause de la qualité de leur enseignement, mais par les nombreuses discussions qu’il avait eues avec les autres étudiants dont il s’était noué d’amitié. Ce qui m’amène à dire que les étudiants d’Histoire devraient instaurer des 5 à 7 à l’Université, comme le font les étudiants d’Études classiques, afin de créer des conditions plus favorables à la fraternisation et à l’échange d’idées… De même, si j’ai un conseil à donner à tous ceux et celles qui commenceront une maîtrise en septembre prochain, c’est de foncer! Foncer au sens de ne pas avoir peur de participer au plus grand nombre d’activités possible dans tout ce qui concerne votre époque d’étude. Car c’est en participant à des colloques, même locaux et même seulement en tant qu’observateur, que l’on rencontre le plus de gens qui s’intéressent à la même époque que vous. Je ne peux donc que vous encourager à participer en grand nombre au colloque annuel qu’organise l’AEDDHUM (l’Association des Étudiants diplômés du département d’Histoire de l’Université de Montréal), dont la prochaine édition se tiendra les 21 et 22 mars 2001. Pour ceux et celles qui s’intéressent à l’Antiquité, le département d’Études classiques de l’Université McMaster (Hamilton, Ontario) organise depuis maintenant deux ans un colloque pour étudiants diplômés, et l’Association canadienne d’Études classiques, dont le colloque annuel se tient toujours au mois de mai, accepte les étudiants de 2e cycle. Ce genre d’activités, qui demande évidemment beaucoup de temps de préparation et qui est souvent assez stressant, peut cependant s’avérer très enrichissant, d’autant plus que c’est dans ce genre d’activités que l’on rencontre le plus de gens susceptibles de s’intéresser à nos propres travaux, sans parler de la précieuse petite ligne à ajouter à votre curriculum vitae. Voilà, je dois me contraindre à mettre un terme à ce texte, car comme plusieurs, j’ai la fâcheuse habitude de m’étendre beaucoup trop (la concision est une qualité aussi rare que précieuse!). De nombreuses idées doivent êtres laissées de côté, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois, qui sait? Pour ceux et celles qui souhaitent me contacter, pour commenter, questionner, discuter ou toute autre chose, n’hésitez pas à le faire en m’écrivant un message au spqr39@hotmail.com. Bibliographie sommaire :Barnes,
T.D. Athanasius and Constantius. Theology
and Politics in the Constantinian Empire.
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1993. 343 p. --------. The
New Empire of Diocletian and Constantine. Cambridge (Mass.), Harvard
University Press, 1982. 305 p. --------. Constantine
and Eusebius. Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1981. 458 p. --------. «Imperial Chronology, A.D.
337-350», Phoenix 34 (1980), p.
160-166. Pour ceux et celles qui s’intéressent à cette période, familiarisez-vous le plus rapidement possible avec les travaux de cet historien, c’est un incontournable. Cameron, A. & P. Garnsey,
édd. The Cambridge Ancient History.
Vol. XIII : The Late Empire, A.D.
337-425. Cambridge, University Press, 1998. chastagnol,
a. L’évolution politique, sociale et économique
du monde romain, 284-363. Paris, SEDES, 19943. 394 p. Chiesa,
G.S. & E.A. Arslan, édd. Atti del Convegno
Archeologico Internazionale : Milano Capitale dell’Impero Romano. Milano
8-11 Marzo 1990. Milan, ET, 1992. 2
vol. digeser, e.d. The
Making of a Christian Empire. Lactantius and Rome.
Ithaca & Londres, Cornell University Press, 2000. 199 p. drake, h.a. Constantine
and the Bishops. The Politics of Intolerance. Baltimore & Londres, Johns Hopkins University Press, 2000. 609 p. Hanson, R. P. C. The
Search for the Christian Doctrine of God. The Arian Controversy, 318-381. Edinbourg,
T & T Clark, 1988. 652 p. JONES, A.H.M. The
Later Roman Empire, 284-602. A Social, Economic, and Administrative Survey.
Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1964. 2 vol. Matthews, J.F. Western
Aristocracies and Imperial Court. A.D. 364-425. Oxford, Clarendon Press,
1975. 445 p. McLynn, N.B. Ambrose
of Milan. Church and Court in a Christian Capital. Berkeley-Los
Angeles-Londres, University of California Press, 1994 (The
Transformation of the Classical Heritage 22). 406 p. Nixon, C.E.V. & B.S.
Rodgers. In Praise of Later Roman Emperors.
The Panegyrici Latini. Introduction,
Translation, and Historical Commentary with the Latin Text of R.A.B. Mynors.
Berkeley–Los Angeles–Londres, University of California Press, 1994 (The Transformation of the Classical Heritage 21). 735 p. RICH, J., éd. The
City in Late Antiquity. Londres & New York, Routledge, 1992. 204 p. Sivan, H. Ausonius
of Bordeaux. Genesis of a Gallic Aristocracy. Londres & New York,
Routledge, 1993. 242 p. VAN DAM, R. Leadership
and Community in Late Antique Gaul. Berkeley-Los-Angeles-Londres, University
of California Press, 1985 (The
Transformation of the Classical Heritage 8). 357
p. Wightman, E.M. Roman Trier and the Treveri. New York & Washington, Praeger, 1970. 320 p.
[1]
Ceux pour qui ce que je dis semble tout à fait farfelu, veuillez consulter
les deux parutions précédentes de Le
Sablier (vol. XVIII, no. 1 & 2 [septembre & octobre 2000],
respectivement aux pp. 14-16 et 23-24.
|