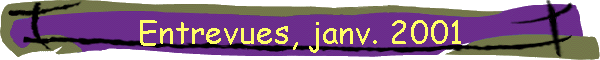
|
|
|
La Révolution n’est pas morteEntrevue avec Claude Morin, pour Le Sablier, 26 octobre 2000
Par Bertrand Vagnon (B.A.
histoire), journalisme Avec la visite de Fidel Castro aux obsèques de Pierre Elliott Trudeau, le 3 octobre dernier, la question cubaine est revenue au centre de l’actualité. Une certaine unanimité apparaît dans les médias occidentaux lorsqu’il est question de Cuba. On présente la révolution cubaine à travers ses aspects négatifs (faillite de l’économie, difficultés de l’agriculture, atteintes supposées aux droits de l’Homme). Claude Morin, professeur titulaire et directeur du département d’histoire de l’Université de Montréal, défend une vision à contre-courant des analyses habituelles. Rencontre avec un défenseur de l’œuvre de la Révolution cubaine et de son architecte, Fidel Castro -
Monsieur Morin, la perception de la Révolution cubaine reste difficile.
Pourquoi ? - C’est à cause de la désinformation. L’information devrait être équilibrée entre ce qu’il y a de négatif et ce qui se fait de positif à Cuba. Or, seules les nouvelles négatives sont présentées. Un biais très fort colore la couverture médiatique de ce pays. -
Qui en sont les artisans ? - Principalement les États-Unis. Même si la guerre froide est finie, Washington garde ce pays dans son « collimateur », car il représente une anomalie : le socialisme en Amérique. C’est pour lui la survie d’une aberration, c’est un anachronisme. Cuba est ainsi décrit sous ses mauvais aspects. Son dirigeant apparaît comme un dictateur et l’avenir de l’île ne peut être que catastrophique. -
Le Canada échappe-t-il à ce phénomène ? - Absolument pas. À cause de notre proximité géographique et de nos convergences idéologiques, les médias canadiens choisissent d’emboucher la même trompette avec seulement des accents moins stridents. Les articles où prédomineraient les points positifs sont rares. Ainsi, certains de mes articles ont été refusés par La Presse et Le Devoir. Ils ont beaucoup de mal à faire valoir un point de vue différent sur Cuba. -
Les Cubains sont-ils victimes de cette désinformation ? - Oui. Ils le sont à travers Radio Marti et de plusieurs stations qui émettent à partir de la Floride. Ces médias ont un point de vue résolument anticastristes. Cependant, TV Marti n’arrive pas à diffuser son signal à Cuba. -
Quel est le but de ce processus ? - Ceux qui sont à Miami veulent encourager les Cubains à la désobéissance, au sabotage, au chapardage, à l’absentéisme. La désinformation vise aussi et surtout les Occidentaux afin d’isoler l’île, en entravant ses relations avec le monde, en limitant le flux de touristes, d’investissements, des échanges. L’isolement doit amener à terme l’effondrement du régime, selon eux. -
Malgré cette désinformation, la Révolution a fêté, en 1999, ses quarante
ans. Qu’est-ce qui légitime encore cette expérience ? - En premier lieu, ce sont les conquêtes sociales réalisées de 1960 à 1990. Le gouvernement cubain assure toujours l’accès gratuit et universel à l’éducation, aux services de santé. Le logement est modique, les loisirs sont bon marché. Le chômage, longtemps inexistant, demeure faible en comparaison avec les autres sociétés d’Amérique latine. Ces conquêtes sont le pivot de la Révolution à Cuba. D’autre part, cette révolution a su défendre la Nation et l’honneur du pays. Les Cubains ont résisté à l’embargo et à la volonté des États-Unis d’en finir avec des dirigeants bien identifiés et le système mis en place, le socialisme. -
Donc pour vous, le blocus américain renforce la position de Castro ? - Tout à fait. L’embargo est un ciment qui soude les Cubains derrière leurs dirigeants. Ces derniers ont réussi à imprimer dans l’esprit de leurs concitoyens une identification entre la Nation et la Révolution, entre la Nation et le socialisme. Ainsi, l’abandon du socialisme signifierait la négation de la lutte nationale qui s’est étalée sur plus d’un siècle. -
Cependant, avec l’effondrement de l’URSS, principal soutien au niveau économique,
cette révolution a dû entreprendre des mutations. - Oui, il a fallu survivre. Ce pays, qui voulait continuer à construire une société socialiste, devait accepter le processus d’insertion dans l’économie mondiale. Cuba s’est ouvert pour sauver l’entreprise sans la dénaturer. Pour prendre une analogie, Cuba a accepté un traitement de choc qui ressemble à la chimiothérapie. Il y a des effets secondaires très désagréables. Mais c’est la condition de sa survie. Cuba a donc accepté le tourisme, les investissements étrangers, l’ouverture au dollar. -
Cette ouverture doit engendrer des inégalités. - Oui, malheureusement. Le plus grand prix que paye Cuba dans cette ouverture est l’accroissement des inégalités. Cela fait mal, car le plus grand succès de cette révolution avait été la réduction des écarts sociaux entre les groupes, les individus, entre la ville et la campagne, entre La Havane et le reste du pays. -
Le gouvernement tente-t-il de limiter cette recrudescence des inégalités ? - Oui. Et c’est en cela que le projet demeure socialiste. Par exemple, le gouvernement a créé un impôt sur les revenus en devises. Ce sont les seuls impôts que paient les Cubains. -
Donc, Cuba ne réintègre pas la voie du capitalisme. - Effectivement. Cuba fera ce qu’il a décidé, à savoir qu’il utilise des moyens modernes correspondant à une économie capitaliste en leur appliquant une logique socialiste. Les investisseurs étrangers feront des profits, suivant des taux de rendement raisonnables. Mais le maître d’œuvre demeure l’État, qui choisit les secteurs ouverts à l’investissement. Ce n’est pas l’ouverture au capitalisme sauvage comme dans le Tiers Monde ou en Europe de l’Est. -
Quelle est la position du Canada dans la mutation que vit actuellement Cuba ? - Le Canada a toujours défendu son droit à faire commerce avec l’île. Aujourd’hui, le Canada estime que des relations commerciales, diplomatiques contribueront à une «démocratisation» du régime. C’est ce qu’on appelle l’engagement constructif. Cette voie est d’ailleurs suivie par les États-Unis dans leur relation avec la Chine. -
Pourquoi les États-Unis ne pratiquent-ils pas cette politique avec Cuba ? - Deux raisons expliquent ce choix : le poids du lobby anticastriste de Floride et l’Histoire. Cette superpuissance ne veut pas reconnaître qu’elle s’est trompée sur Cuba. Elle a vu la voie prise par la Révolution comme une trahison, refusant d’admettre que les Cubains puissent adopter librement un autre système que le système capitaliste et le multipartisme. -
Les États-Unis n’ont donc jamais accepté de perdre leur pré carré en 1959
? - Exactement. C’est comme une relation de famille, lorsque le fils a rompu avec le père. Aussi longtemps que Castro sera vivant, ce sera très difficile pour les États-Unis de revoir leur politique cubaine. Ils ont personnifié Cuba à Fidel Castro. Or, ceux qui suivent l’actualité cubaine savent que Fidel est loin d’être tout à Cuba. Castro est la référence publique, celui qui rassure. Il incarne la révolution, la résistance. Mais il ne décide pas seul. Il appartient à une équipe dont la direction est collégiale. Fidel Castro n’est plus l’homme incontournable. Il a appris à partager, à déléguer. Surtout, il faut dire avec force que Fidel Castro est aussi un élu, car il y a des élections périodiques à Cuba. -
Donc, l’erreur est de croire qu’après Castro, la Révolution va
s’effondrer. - Oui. Elle ne s’effondrera pas, car il y a derrière Castro une équipe qui prendra plus de visibilité. -
Est-ce qu’il prépare cette éventualité ? - Oui, mais il faut faire attention. Quant on dit que Castro facilite l’ascension d’une personne, on le considère comme un monarque qui prépare sa relève. Les choses sont beaucoup plus subtiles. Il y a un équilibrage au sein du pouvoir. Ceux qui émergent le font grâce à leurs qualités personnelles reconnues par l’ensemble de l’équipe. -
Pour en revenir au Canada, est-ce qu’il se trouve seul sur la scène
internationale à favoriser l’accroissement des échanges avec Cuba ? - Absolument pas. C’est d’ailleurs
les États-Unis qui se trouvent isolés dans leur attitude revancharde et
hostile. Le Canada est soutenu par l’Union Européenne qui partage ses vues
sur l’engagement constructif. -
Il y aura bientôt des élections aux USA. Est-ce qu’un candidat se démarque
sur le dossier cubain ? - Je ne crois pas. De toute façon, pour que la situation change, il faudrait une majorité démocrate au Congrès. Ce n’est pas le président qui va changer l’orientation de la politique envers Cuba. C’est une politique interne liée à la capacité de neutraliser les Cubains de Floride et les groupes réactionnaires de la classe capitaliste. Actuellement, le Congrès, à majorité républicaine, présente des assouplissements à l’embargo. Mais c’est de la poudre aux yeux dans la mesure où ils sont assortis de durcissements sur le tourisme et qu’ils privent Cuba de crédits pour faire des échanges. -
Cuba s’est-il relevé du tourbillon des années 90 ? - Oui. La situation n’est pas encore celle d’avant la crise, en 1989, mais le pire est passé. Depuis 1995, les indices macro-économiques montrent un redressement. -
Cette épreuve a-t-elle renforcé la Révolution ? - Je ne sais pas si les Cubains mourraient pour le socialisme. Mais l’identification entre la Nation et le socialisme est telle que les gens ne désirent pas revenir en arrière. C’est un peu comme s’il n’y avait pas d’autres solutions. Il leur semble plus facile de continuer dans ce système, surtout si une embellie apparaît. Si des dizaines de milliers de Cubains rêvent de Miami, la majorité ne souhaitent pas «un retour de Miami. » Ce qui a vécu, c’est un socialisme paternaliste du tout-à-l’État. Le socialisme cubain doit admettre plus d’initiative individuelle. -
Finalement, Cuba est-elle la seule nation de l’Amérique latine ? - Par défaut, oui. Ce pays a un haut degré d’autonomie. Surtout, les Cubains sont fiers d’avoir développé un projet économique, politique et social original. Ceux qui veulent en savoir plus sur la question cubaine et sur monsieur Morin peuvent visiter le site Internet suivant : www.fas.umontreal.ca/HST/HST374. Ils trouveront ses derniers travaux, son cursus et quelques notes plus personnelles. Le site renvoie à une vaste bibliographie sur Cuba ; et présente le voyage annuel organisé dans l’île de Fidel Castro. |