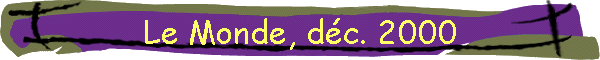Le Monde du Bout du Monde
Par Dimitri Latulippe
maridimi@sympatico.ca
Du plus loin que je me
souvienne, du fond de ma chambre de p’tit cul, j’ai toujours associé ce
monstre mythique de sous mon lit à l’escogriffe rouge de l’Est décrit par
le Dieu carré qui gisait dans le salon de mes parents. J’étais terrifié par
ce dragon incongru non identifiable que l’on me décrivait dans les films,
dans les histoires, dans la légende populaire. Puis, une princesse fit son entrée.
Sacrée avant son ascension, elle proposait au Minotaure une alternative imposée
: acceptation ou annihilation. La démocratie occidentale avait scellé le sort
du mythe avant qu’il naisse ; l’Ouest avait vaincu l’Est par sa
magnificence, l ‘idéal idéologique de la Vénus avait terrassé la
rusticité et la primitivité de la tentative. Sans jamais la vouloir, le
monstre devait accepter cette princesse et tenter de cohabiter pour ainsi espérer
concilier le roi qui menaçait de retirer l’héritage et le testament, si sa
progéniture devait être répudiée.
Les pieds bien enfoncés
dans ma paire de bottes neuves, j’initiai mon odyssée nomade qui devait me
faire parcourir une bonne parcelle de l’ex-URSS, à Tachkent, Ouzbékistan, le
15 février 2000. Première constatation: l’ancienne république socialiste
soviétique n’est pas et n’a probablement jamais été la Russie. Le
Kazakhstan, le Kyrghystan et la Sibérie ne sont pas la Russie que nos démagogues
occidentaux tentent perpétuellement de nous le faire croire. La Russie de l’Ouest
est très loin de ressembler à ses ex-colonies orientales. Ayant trottiné à
travers ces vastes territoires (comme il en sera question plus tard, si tout va
bien), j’ai senti le sol ouzbek beaucoup plus sablonneux, résolument plus
asiatique et davantage musulman que ce que j’ai pu apprécier du reste de l ‘ancienne
URSS. J'étais venu en quête d’un peuple chaotique noyé par 70 ans de déconstruction
intentionnelle, j’y ai trouvé une nation à la poursuite de son histoire,
cherchant dans ses propres racines un absolu nationaliste inéluctablement
atrophié.
Irrémédiablement ancré
dans sa tradition islamique, l'Ouzbékistan a probablement les reins économiques
les plus solides, les assises politiques les plus stables et la population la
plus dynamique des anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale. En sa
qualité de pays le plus peuplé et supposément le plus riche, on pourrait
croire que la nation aspire en un futur occidentalement «normal». Le problème
subvient lorsque l’on met en perspective les atouts qui nous permettent
d’arriver à ces présomptions. L’Ouzbékistan est effectivement riche en
ressources naturelles, mais à l'instar des autres ex-républiques soviétiques,
elle partage l’exploitation de ses ressources avec les charognards occidentaux
qui déchiquettent la carcasse des pays à développement plus lent. De plus,
les dissensions internes entre conservateurs et libéraux empêchent le
consensus politique. De fait, de la Ferghana Valley à l'est jusqu'aux confins
de la République du Karakalpakstan à l’ouest une kyrielle de courants
s'affrontent. Des islamistes misonéistes aux nouveaux riches des réformes
post-soviétique, le contexte favorise l’ascension d'hommes plutôt
despotiques à l’ancienne sauce communiste. Ainsi, Islam Karimov, ancien
membre du PC ouzbek et partisan d’un État rétrograde et réactionnaire,
gouverne d’une main de fer un parlement marionnette aux traditions trop peu
revendicatives pour exprimer le désir de s’affranchir d’un système mis en
place dès 1918. La population, bombardée de propagande et réduite au silence
pendant presque l’entièreté du XXe siècle, est peu encline à se mobiliser
et à utiliser les leviers démocratiques nouvellement acquis pour remettre en
question l’échiquier monopolistique de son autocrate. Donc, peu de
changements au quotidien pour ces Ouzbeks qui sont passés d’un État
communiste totalitaire à un État policier, où les forces de «l’ordre»
dictent et régissent le moindre mouvement de l'étranger comme de l’habitant.
La police transforme l’Ouzbékistan d’état incertain à état carrément
dangereux. Pour terminer ce tour d'horizon, rappelons que le gouvernement, dans
son empressement à devenir partenaire de la machine capitaliste, neutralise
toute tentative de renouveau réel : l’environnement est saccagé (Mer d’Aral),
la santé est en sérieuse régression et le taux de scolarisation ne cesse de
fondre au soleil.
Alors pourquoi ?
Pourquoi venir se rôtir les fesses dans ce paradoxe de la mondialisation
croissante ? Pour les gens. Pour les Ouzbeks. Pour ces femmes, pour ces hommes,
pour ces enfants qui y vivent, pour ces survivants qui n’ont pas choisi d’y
vivre, mais qui prospèrent dans leur ataraxie bien nationale. L’Ouzbékistan
a résolument décidé d’emprunter la voie de la distanciation face au grand
frère russe, de manière peut-être encore plus définitive que ses cousins
d’Asie centrale. Les politiques gouvernementales sabrent et saccagent
constamment l’héritage russe au profit d’un renouveau ethnique et d’une
redécouverte d’un passé encore plus glorieux que les Ouzbeks eux-mêmes
pourraient souhaiter. Ainsi, les Russes sont en voie d'être surpassés par les
Turcs au niveau des influences culturelles, sociales, économiques et
politiques. Un retour vers les bases d'un islamisme moins rigoureux qu’au
Moyen-Orient, mais plus rigide que dans les états voisins (exception fait du
Tadjikistan, très proche de l’Afghanistan) peut être la source de cette
distinction fondamentale. Le musulman ouzbek, fort d’un bagage de 70 ans de laïcisation,
accueille chez lui l’étranger avec une pointe de curiosité, mais surtout
pourvu d’un profond respect. N’étant nullement crédule sur les différences
profondes qu’il existe entre son monde et le nôtre, il avance fermement, mais
consciencieusement, que la différence est précisément la force de sa culture.
Le chaotique, la saleté, la rareté et le précaire font partie de leur vie,
mais c’est ainsi qu'ils conçoivent l'existence. D’aller marchander au bazar
multicolore de Samarkand la bienheureuse, de prendre le thé vautré sur un lit
gigantesque en plein air au milieu de Buchara la ténébreuse ou de célébrer
un nouveau mariage à l’intérieur des fortifications de Khiva la nostalgique,
c’est l’essence de l’existence pour un peuple simple redécouvrant les
fondements d'une culture trop longtemps menacée. La destinée équanime de ce
monde du bout du monde a vu Genghis Khan les anéantir, Tamerlan les glorifier
et Lénine les endoctriner. Le doux vent de l'Aral dans le dos, le Registan en
effigie et le Labi-Hauz en icône ouvrent la voie vers une reconquête du monde
qui jadis vit Marco Polo célébrer ses merveilles fastueuses.
15 mars. Assis dans la
gare de train, j’attends le 9h15 en direction de Alma Ata, Kazakhstan. Je vais
devoir lutter pour pénétrer dans le wagon, je vais devoir argumenter pour
franchir la douane et je vais probablement passer les 24 prochaines heures les
plus pénibles de mon existence, mais pour l’instant, c’est le calme plat.
L’anarchie normale des transports ne m’atteint pas encore parce que pour
l’instant, j’observe et je décante. Je pense à mon monstre rouge, puis je
les observe et j’essaye de comprendre. Je tente de saisir l’arbre par les
branches. Pour y arriver, il est impératif d’être rigoureusement méthodique.
De un, se trouver un endroit à l’écart, puisque l’observateur perd son
objectivité essentielle lorsqu’il se sent détecté. J’y suis. Ensuite,
s’ingénier pour saisir un instant bref, une signifiante parcelle de leur
nature pour en puiser la singularité. Puis réfléchir, peser et décortiquer
l'être. À cet instant, si tout est favorable, si les conditions gagnantes sont
présentes, alors il nous est possible d’approcher la particule indissociable,
le fondamental qui explique un tel désordre, une telle fragrance, un chaos si
articulé, une finesse si corrompue. Pourquoi l’enfant nous démasque-t-il si
rapidement ? Pourquoi sa réaction ne sait feindre la surprise? Pourquoi suis-je
incapable de me fondre en lui ? Si l’instinct, si la scission première entre
peuples, si la naïveté, si l’incompréhension expliquent ce détachement
profond entre nations d'un même monde, que fait-on de la culture, la grande
culture supranationale ? La culture mondiale et la diversité ethnique se
calculent-elles à partir d’un coefficient abstrait ou selon des critères
extra-singuliers ? Le monde reste et restera toujours à l’envers, quel que
soit son point d’origine géographique... Aujourd'hui,
je suis Ouzbek, comme eux. Et ça, jamais personne ne pourra les
convaincre du contraire.
Si tout va bien, le
monde des Kazakhs devrait suivre ce texte purement personnel où le contenu est
retenu à la source que par le bon désir du communicateur.
Haut de la page
Index - Le Monde