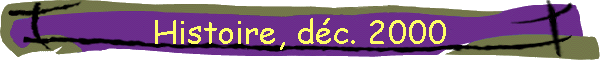
|
|
|
De
l’esclavage au castrisme[1]
La genèse d’un mouvement Par Marc-André Durand [n.d.l.r.: La première partie du présent article a été publiée dans la parution de décembre 2000 du Sablier (p. 21) et la deuxième, dans celle de janvier 2001 (p. 21).]
La révolution cubaine
a produit une littérature où mauvaise foi et sarcasme s’opposaient aux écrits
apologiques et subjectifs. L’Europe d’abord qui tire de l’aventure cubaine
une inspiration sans borne à l’heure où le communisme, selon un modèle soviétique,
s’enlise. Dans les années soixante et soixante-dix, la gauche et l’extrême
gauche, particulièrement française, n’ont pas cessé d’aller chercher dans
les batailles d’Amérique latine de quoi alimenter leurs rêves de révolutionnaires.
François Maspero écrit 30 ans après : «Il est peut-être difficile
aujourd’hui de comprendre ce qu’a représenté la révolution cubaine pour
cette poignée de militants européens. Ce fut une immense vague d’espoir. ».
Tous ces écrits, autant de français pro-castristes que de pro-américains
accusés d’être des agents de la CIA[2],
portent d’emblée une marque indélébile : leur belle ignorance du long
processus de combat pour la liberté dont le dernier volet est le castrisme.
Tout d’abord, la révolution
cubaine, mais surtout le gouvernement actuel de Cuba est l’œuvre d’une
grande équipe dirigeante à Cuba. Ainsi, l’épithète castriste ne saurait être
ramenée à un seul homme, même s’il en est le principal porte-parole.
C’est en 1869 que se
déclencha pour dix ans la première révolution cubaine. Depuis, le peuple
cubain n’a jamais arrêté son combat pour l’indépendance. Cette guerre de
Dix ans, amorcée par des propriétaires terriens de la région d’Oriente,
amena la proclamation d’un gouvernement de «Cuba
libre », type démocratico-bourgeois[3].
L’Espagne garda jusqu’à la fin du XIXe siècle un système
esclavagiste. De nombreux esclaves, libérés et armés par la bourgeoisie créole,
firent la révolution dans un Cuba appelé à devenir le leur[4].
Appelés les Mambis, leur courage révolutionnaire
resta légendaire. Cette guerre de partisans qui dura une décennie se termina
par un compromis imposé par le général Martinez Campos : le pacte de
Zanjón (1878). Les États-Unis n’ayant pas aidé les insurgés, le
gouvernement de Cuba libre devint un véritable
symbole de liberté.
Cette non-intervention américaine donna une leçon aux
Cubains qui se concrétisa en la personne de José Martí. Les conspirations
bourgeoises qui suivirent ne rencontrant que l’échec, il revint à Martí de
démontrer que la bourgeoisie ne pouvait remporter la victoire sans l’appui
des masses populaires.
Né en 1853, fils d’un sergent espagnol, Martí fut
condamné à seize ans au bagne pour avoir stigmatisé ceux qui collaboraient
avec les milices intégristes de la colonie. Il fut exilé en Espagne, connut la
Première République française. Il vécut au Mexique, au Guatemala, revint à
Cuba à la fin de la guerre en 1878, fut recondamné à l’exil en Espagne,
visita le Vénézuela, puis se fixa aux États-Unis pour quatorze ans comme
journaliste, orateur, poète et organisateur de la guerre de libération cubaine
de 1895. Il y réalisa l’unité des groupes révolutionnaires contre l’Espagne,
jeta les bases d’une nouvelle république, pour le bien de tous sans
distinction de race ou de situation sociale. Selon lui, après la confrontation
inévitable avec l’Espagne, Cuba devra se libérer de l’emprise sociale américaine,
sa «seconde indépendance ». Martí devint ainsi le premier penseur
anti-impérialiste de l’Amérique hispanique. Il démontra dès la décennie
de 1880 que Cuba et Puerto Rico étaient menacés par le panaméricanisme.
C’est donc en 1892 qu’il met sur pied le «Parti révolutionnaire cubain »
chargé d’organiser la guerre révolutionnaire. Il lança en 1895
l’insurrection de février et débarqua sur les côtes cubaines avec ses
combattants. Il fut tué par les Espagnols le 19 mai.
Puis sur la conduite de chefs comme Antonio Marcea et Máximo
Gómez, les Mambis luttèrent contre
une Espagne qui désespérait de conserver sa dernière colonie[5].
Les États-Unis offrirent à Madrid d’acheter Cuba pour 300 millions de
dollars. Cette dernière refusa. L’explosion du cuirassé Maine, probablement par les Américains eux-mêmes, permit aux Américains
de déclarer la guerre à l’Espagne. Anéantissant la flotte espagnole, les Américains
entrèrent à Cuba.
Les Mambis,
qui dominaient l’armée espagnole sur le terrain et qui pensaient
l’emporter, furent écartés de la victoire, licenciés du pouvoir. Le drapeau
américain prit la place de l’espagnol à La Havane, ce qui resta dans la mémoire
collective comme une immense frustration. Pour le peuple, Cuba n’avait que
changé de maître.
Le tournant du siècle vit un pays ruiné et enclavé.
L’économie était au service du trust.
Cet échec de 1898 resta présent dans l’esprit cubain jusqu’aux rebelles de
1959. Après Martí, c’est Fidel, dit simplement le peuple. On retrouve
naturellement Martí dans l’introduction de tous les textes importants de la révolution,
de L’Histoire m’acquittera[6]
au Préambule de Statuts du Parti communiste cubain, en passant par la
Seconde Déclaration de la Havane et la Constitution de Cuba.
La lutte communiste débuta à Cuba avec le XXe
siècle. C’est en 1904 que le Parti ouvrier de Cuba fut créé à La Havane et
qui adopta l’année suivante la doctrine marxiste en prenant le nom de Parti
ouvrier socialiste. La Fédération ouvrière à La Havane et le Syndicat des
Cheminots de Cuba furent respectivement créés en 1920 et 1924. Cette phase
d’un mouvement ouvrier réel à Cuba se continua en 1925 par la création de
la Centrale nationale des ouvriers de Cuba qui fera place en 1938 à la Centrale
des Travailleurs de Cuba. La CTC adhérera en 1945 à la FSM. Cette évolution
du mouvement ouvrier cubain est inséparable de celle du Parti communiste[7].
C’est en mai 1923 que les membres radicaux du Parti ouvrier socialiste créèrent
le Groupe communiste de La Havane[8].
En 1925 se forma le Parti communiste de Cuba, qui resta illégal jusqu’en
1937. Il redeviendra illégal en 1953 à la suite de l’assaut de la caserne
Moncada.
Il convient de noter la venue de Julio Antonio Mella,
dont le castrisme s’inspirera plus tard. Étudiant brillant né en 1903, il
fonde en 1922 la Ligue anticléricale de Cuba et, en 1924, la Fédération des
Étudiants universitaires. Il combattit la dictature de Gerado Machado et
participa à la fondation du Parti communiste (PC). Mella se prononça pour la
formation d’une union anti-impérialiste composée d’ouvriers, de paysans,
d’étudiants et d’intellectuels. Au centre de sa pensée se trouvait le
problème du nationalisme et de la libération nationale. Il soutint les combats
de Sandino au Nicaragua, se posant ainsi comme un internationaliste convaincu.
Comme les castristes plus tard, il se considérait disciple de José Martí, héritant
de son message démocratique, révolutionnaire et anti-impérialiste.
Aux élections de 1939, le PC s’unit avec le Parti
d’union révolutionnaire et Juan Marinello. Cette nouvelle union marxiste-léniniste
devient, en 1944, le Parti socialiste populaire (PSP) qui présente en 1948
Marinello comme président. Malgré l’ambassade américaine qui oriente les élections
et une fraude à grande échelle, le PSP obtint 10% des votes. En 1952, les
communistes appuient le plus progressiste des partis, le Parti orthodoxe, où
milite Fidel Castro. Au contact de communistes dont il lit les manifestes, le
livre de chevet de Fidel devient l’État
et la Révolution de Lénine. Le 28 janvier 1953, Fidel conduit des milliers
de jeunes pour rappeler à tous la naissance de Martí. Il est clair qu’à
cette époque, Fidel cherche à préparer une relève radicale face à l’indécision
du Parti orthodoxe. Le 26 juillet 1953, les fidelistes attaquent la caserne de
Moncada, leur entreprise se soldant par un échec. Le PSP n’approuve pas, déclarant
qu’il s’agit d’une action putschiste. Le PSP préconise une grève générale
jusqu’au soulèvement, mais soutient tout de même Castro lors de son procès.
En mai 1955, le dictateur Batista accorde l’amnistie aux fidelistes. Fidel
part pour le Mexique afin de planifier l’invasion de l’île. Les étudiants
et les travailleurs du sucre organisent une mobilisation générale pour la fin
de la dictature.
En décembre 1956, Fidel Castro débarque à Cuba. Son
armée révolutionnaire est pratiquement anéantie par les forces du dictateur
Batista à cause d’un décalage horaire. Douze hommes survivent à
l’attaque, se réfugiant dans les montagnes, formant le fameux foco
de la guérilla. Pendant l’année 1957, la guérilla s’accroît et met sur
pied une véritable organisation militaire et civile : hôpital, journal,
école, etc. En février, une station de radio permet à Fidel de s’adresser régulièrement
au peuple cubain. Le 2 janvier 1959, les rebelles entrent gagnants à La Havane.
Ce fut une victoire totale sur tous les points de vue.
Ainsi, nous pouvons voir, par une analyse certes
marxiste mais surtout historique et événementielle, que le castrisme n’est
que le résultat, la finalité d’un long développement historique. En un siècle,
Cuba passe de colonie à symbole. C’est son développement historique qui
finalement prendra forme dans son épithète «castrisme ».[9] BibilographieCastro,
Fidel. L’histoire m’acquittera. La Havane, Institut cubain du livre,
1975. 205 pages Chaliand,
Gérald. Terrorisme et guérilla. Bruxelles, Éditions Maisonneuve. 210
pages. Cormier,
Jean. Che Guevara. Compagnons de la révolution. Rome, Gallimard, 1996.
143 pages. (Coll. «Histoire »). Delaune,
Philippe. « Fidel Castro :du barreau au pouvoir ». Historia,
no 517(janvier 1990), pp. 86-97. Encyclopédie
Universelle Illustrée.
Montréal, Éditions Maisonneuve. Frank,
Robert. Histoire 1erG. Paris, Éditions Belin. 207 pages. Holmes,
Richard et al. Atlas historique de la guerre. Londres, Hachette, 1989. p. 261. Lamore,
Jean. Le castrisme. Paris, Presses universitaires de France, 1983. 126
pages. (Coll. «Que sais-je »). Nidergang,
Marcel. « Castrisme ». Encyclpaedia
Universalis. Paris, Encyclopaedia Universalis, vol. 5, pp.56-59. Ritchie,
E et A Fried. Les temps modernes. Québec, Éditions Maisonneuve. 1436 pages. Szulc,
Tad. Fidel Castro, trente ans de pouvoir
absolu. Montréal, Éditions du Roseau, 1987. 684 pages.
[1]
Par castrisme, cet
article entendra trois sens : celui qui prévalait entre 1953 et 1959,
c’est-à-dire le mode de prise de pouvoir tel que pratiqué à Cuba, puis
à certains endroits, bien que ceci ne soit pas spécifiquement traité, «castrisme »
rapportera à ce mode cubain particulier de passage au socialisme ainsi
qu’à la politique extérieure cubaine. [2]
Par exemple, K.S Karol et René Dumont [3]
10 octobre 1868 [4]
Les noirs et les mulâtres forment aujourd’hui 25% de la population
cubaine. [5]
Bolívar avait déjà libéré la Colombie, le Vénézuela, l’Équateur,
le Pérou et la Bolivie. Bolívar avait entrepris d’établir une ligue des
États hispano-américains. Président de trois républiques, Bolívar se
donna des mandats à vie. Mais la grande République hispano-américaine ne
vit jamais le jour : l’Amérique latine se fragmentait en guerre civile.
«L’indépendance est le seul bénéfice que nous ayons obtenu, au détriment
de tout le reste » avait-il dit avant sa mort, le 17 décembre 1830.
Ainsi se libéra, par ordre chronologique,
Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti), le Vénézuela (qui sera ensuite
repris), les Provinces-Unies (future Argentine), le Chili, la
Nouvelle-Grenade, encore le Vénézuela, le Mexique, le Pérou, le Haut-Pérou
(rebaptisé Bolivie en l’honneur de Bolívar) et ainsi de suite jusqu’en
1826. [6]
«Afin de faire
comprendre que j’étais résolu à lutter seul contre tant de bassesse, je
citais dans ma lettre cette pensée de José Martí : “Un principe
juste, du fond d’une caverne, peut accomplir plus qu’une armée.” ». [7]
Il ne s’est pas
développé de parti social-démocrate à Cuba. [8]
Son vice-président, Carlos Baliño, était un ancien compagnon de Martí. [9]
C’est
consciemment que mon texte s’arrêtera sur la victoire fideliste, ne s’étendant
pas sur le développement du castrisme post révolutionnaire, la fameuse révolution
dans la révolution et que je n’ai pas fait mention des influences, très
limitées pour l’époque étudiée, de personnalité internationale sur
Cuba |