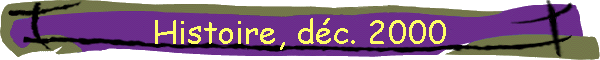L’ABC du démocrate
Par Chad
D. Dublois
Les hommes, jadis libres de toutes contraintes, se regroupèrent en
communautés pour mieux résister à l’hostilité de la nature et
s’entraider pour diverses activités. Depuis sa condition d’hominidé et même
au-delà, les primates qui précédèrent l’homo sapiens sapiens formèrent déjà
les embryons d’une société avec une véritable hiérarchie. Tout au long du
Paléolithique et ce, jusqu’à notre société se trouvant à l’aube d’une
troisième révolution industrielle (la révolution informatique) en passant
bien entendu par l’incontournable Néolithique, les relations entre les
humains devinrent sans cesse plus
complexes au sein des sociétés naissantes. Or, la vie en société exigea de
l’homme qu’il abandonne une partie de sa liberté pour participer à une œuvre
commune et à l’établissement d’une autorité qui transcende celle des
individus : l’État.
Au fil des siècles, les États et les hommes se sont
dotés de différents systèmes d’exercice du pouvoir : monarchie (ou
tyrannie), théocratie, oligarchie, démocratie, etc. À cet égard, les Grecs,
plus particulièrement les Athéniens, furent les premiers dans l’histoire de
l’humanité à proposer une participation politique
au peuple formé des citoyens au VIe siècle av. J.-C.. Toutefois, les
citoyens (des hommes de parents athéniens) formaient une minorité dans l’Attique :
les femmes, les esclaves et les métèques ne pouvaient y participer. De surcroît,
plusieurs éléments entravaient l’exercice de cette démocratie : la
constitution censitaire du réformateur Clisthène (qui faisait en sorte que
seuls les individus les plus fortunés pouvaient accéder aux magistratures supérieures),
les problèmes liés à l’importance qu’occupait la rhétorique dans les débats
des assemblées, le fait que certaines magistratures étaient non-rémunérées,
et l’éloignement de la ville d’Athènes pour un bon nombre des habitants de
l’Attique.
Dans la ville de Rome se développait lentement une
société plus égalitaire, en théorie du moins, entre les deux ordres qui
constituaient la ville : les patriciens et les plébéiens. Sous la république,
vers 450 av. J.-C., les plébéiens (ou le peuple) obtinrent la mise à l’écrit
du droit avec la loi des douze tables. Cela demeure encore un important moment
dans notre histoire, car la loi ne pouvait plus alors faire l’objet de
l’interprétation arbitraire des élites. Malgré le caractère fortement
aristocratique de la république romaine, les plébéiens purent aspirer à plus
d’égalité entre les individus grâce à cette mise à l’écrit du droit.
Cependant, le but de cet article n’étant pas de décrire
les deux systèmes politiques fondamentaux à l’origine de notre conception
occidentale du pouvoir, il me semblait nécessaire, à tort ou à raison, d’en
souffler quelques mots bien que cela me paraisse qu’un survol des plus
fugitifs. D’abord parce que la démocratie athénienne et la république
romaine continuent de hanter notre imaginaire collectif en tant que
civilisation. Ensuite, parce qu’elles éveillent en nous des idéaux bien plus
élevés qui éclipsent les lacunes de ces deux systèmes.
Ces idéaux dont se réclame notre civilisation et ce,
particulièrement en ce qui concerne la démocratie, témoignent de la place
importante accordée à cette dernière. Mais qu’est-ce que la démocratie?
L’étymologie nous apprend que le mot démocratie provient du grec dêmos
(peuple) et kratos (pouvoir) et qui
signifie donc «pouvoir du peuple ». D’autre part, le dictionnaire définit
la démocratie comme suit : «Régime politique dans lequel le peuple
exerce sa souveraineté lui-même, sans l’intermédiaire d’un organe représentatif
(démocratie directe) ou par représentants interposés (démocratie représentative) ».
Or, peut-on affirmer que le peuple exerce une véritable
souveraineté politique au sein des institutions qui le gouvernent en cette ère
de la communication ? Sûrement pas, surtout si l’on s’attarde par exemple
au système politique canadien : une monarchie constitutionnelle de type
parlementaire. En effet, notre système politique est loin de posséder les
attributs d’une véritable démocratie et pour expliquer cela, certains
rouages du système sont essentiels à comprendre. Primo, l’exécutif (le
cabinet et le Premier ministre) peuvent s’arroger beaucoup de pouvoir d’une
façon fort simple : les députés membres du parti majoritaire (parce
qu’un système parlementaire de type britannique tolère mal qu’il y ait
plus de deux partis importants) votent nécessairement dans le sens de leur chef
(le Premier ministre); c’est ce qu’on appelle le phénomène de la ligne de
parti. Secundo, le Premier ministre a le loisir de présenter à peu près tous
les projets de loi qu’il désire puisque qu’il est certain de bénéficier
de l’appui de ses députés qui sont majoritaires (le système britannique est
ainsi fait). Par conséquent, le rôle de l’Assemblée des députés, censée
représenter les intérêts populaires, est réduit à celui d’un lieu de débat.
Sans parler des relations fédérales-provinciales où le fédéral tente d’étendre
son pouvoir au détriment des provinces. Toutefois, cela n’est pas propre au
Canada; il en est de même dans beaucoup de pays.
Tout cela pour en arriver à l’évidence qu’une réforme
est nécessaire pour instaurer un véritable régime démocratique. La
population peut désormais aspirer à participer aux décisions, ne serait-ce
que grâce aux innovations technologiques actuelles. Par exemple,
l’informatique nous permet déjà de communiquer en direct sur n’importe
quelle distance. Imaginons que les citoyens puissent présenter, grâce à
l’informatique, des projets de loi à l’Assemblée nationale ou aux
Communes, peu importe l’endroit où ils habitent au pays ou dans la province.
Le système représentatif deviendra un archaïsme avec le temps puisque les
citoyens voudront s’exprimer eux-mêmes et qu’ils pourront le faire.
Je vais encore plus loin dans ma réflexion : le
régime parlementaire n’a plus sa raison d’être à cause des éléments énoncés
ci-haut. Pourquoi ne pas se convertir à un régime républicain tout en faisant
en sorte que le principe de la ligne de parti disparaisse ? Tiens ! Pourquoi ne
pas faire disparaître les partis ? Ainsi, les députés pourraient voter selon
leur bonne conscience en limitant la pression des différents lobbies sur eux.
Pourquoi ne pas mettre sur pied un véritable organisme avec certains pouvoirs
ayant comme mandat de surveiller l’exercice le plus complet de la démocratie
et défendre les intérêts des citoyens devant le grand capital et le
politique.
Enfin, ces quelques suggestions peuvent paraître irréalisables.
Or, la volonté d’un peuple peut arriver à modifier notre système actuel
pour qu’il reflète davantage les aspirations de la population pour en arriver
à une démocratie plus directe. Une démocratie plus directe dynamise la société
et lui insuffle une plus grande vitalité. Cette vitalité engendre des remises
en question par la voie de la contestation. Aussi, cette compétition politique
donne lieu à une plus grande efficacité de ceux qui travaillent au service de
l’État et donc, au service des citoyens. Par conséquent, un poste au sein du
gouvernement pourra davantage se justifier par le mérite des individus qui y
accéderont.
L’article 1 de notre nouvelle constitution : Le
gouvernement défendra les prérogatives de la démocratie afin d’assurer
l’exercice de celle-ci par tous les citoyens, peu importe leur origine, leur
croyance, leur statut social et leur statut économique.
Salus populi suprema lex esto; « Que le
salut du peuple soit la suprême loi »
Devise du droit romain.
Haut de la page
Index - Histoire