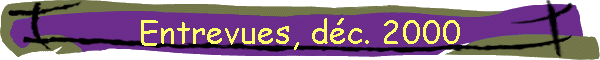« Nous
vaincrons…»
Une
entrevue avec Pierre Falardeau
Par Bryan Pettiford, avec la
collaboration spéciale de Jonathan Meilleur
Le
5 octobre dernier, une équipe du Sablier a eu le privilège de rencontrer le
cinéaste indépendantiste, Pierre Falardeau.
Le moment tombait bien puisqu’il s’agissait du trentième
anniversaire du début de la crise d’Octobre.
Or, dans une rencontre très amicale, nous avons cherché à connaître
l’homme qu’est Pierre Falardeau, au-delà de l’image publique que nous en
connaissons tout en abordant des sujets qui nous semblaient pertinents et
d’actualité. Voici donc, en
version quasi intégrale, le compte-rendu d’une entrevue avec celui qui se
veut un chantre de la cause souverainiste et qui, malgré 40 ans de lutte,
continue de clamer : « Nous vaincrons… ».
Le Sablier - Le nouveau film que vous
sortirez en février prochain a connu beaucoup de problèmes de financement,
particulièrement en ce qui concerne les subsides provenant des organismes fédéraux,
dont Téléfilm Canada. Dans quelle
mesure croyez-vous que l’État, par ses politiques de financement, exerce un
contrôle de l’appareil idéologique ?
Pierre Falardeau - « Moi, je pourrais dire que je pense
que oui… Moi, c’est pas juste je pense… C’est pas parce que j’ai
l’esprit tordu… Mais, les États, quels qu’ils soient, qu’ils soient
capitalistes, communistes ou islamistes, féministes, fédéralistes, savent que
les outils de communication, c’est des outils puissants, donc ils les contrôlent.
C’est pour ça qu’il y a le CRTC. Les organismes fédéraux ne sont
pas là pour rien, ils sont là pour aider les gens, mais sont là aussi pour
contrôler ce qui se passe. C’est eux autres qui donnent l’argent. Donc, les artistes qui
vont là ont intérêt à marcher droit puis à penser droit, sinon tu
travailles pas. Si tu veux travailler à
SRC, faut que tu marches droit. Il
te donne un manuel et il faut que tu le lises ? …Non, il te
donne pas de manuel, t’as pas de besoin de manuel, le monde le sait.
Tout est bas, les gens qui engagent d’abord ils engagent des gens qui
sont «safe», pas dangereux, qui pensent comme eux-autres.
Pis tout le monde le sait, si tu fais des films, si tu commences à l’ONF
et admettons que bêtement tu dises : je voudrais faire un film sur la
crise d’Octobre, ils vont dire : c’est pas très intéressant. Ou tu te
dis : je veux faire un film sur la Conquête.
Ils diront : ah! ça déjà été fait, on n’a pas besoin de ça.
Tu t’aperçois qu’il y a plein de sujets que tu ne peux pas traiter
parce que tout le monde a peur dans tout l’appareil : les producteurs ont
peur, les réalisateurs ont peur, les secrétaires ont peur, le boss a peur,
tout le monde a peur… L’État contrôle un certain nombre d’appareils… C’est
bizarre que l’on dise que le Canada soit un pays libre mais que ça en vienne
à cela malgré tout …Mais c’est des conneries, il ne faut
pas croire tout ce que l’on dit… »
« SRC par exemple, ça été une boîte fédérale, une
boîte du gouvernement fédéral. Mais
pendant des années, il y a plein de monde qui ont travaillé là qui ne sont
pas des imbéciles, qui sont des Québécois qui essaient de faire quelque
chose. Dans les années 1970, quand
Trudeau a dit : « bon là c’est fini les folies à SRC », SRC
était vue comme une boîte de séparatistes parce que c’était des
intellectuels québécois qui allaient travailler là, ils étaient tous indépendantistes.
Ils ont dit : là tabarnak ça fait.
Alors, ils nomment au Point, comme rédacteur en chef, un gars qui
s’appelait Thibeault qui venait directement de son bureau [de Trudeau].
Alors on se dit : ça va parler de quoi le Point ?
Si tu sors l’organigramme de SRC, c’est qui le boss des nouvelles ?
C’est qui le boss du Point ? Puis là tu regardes et tu te dis : ah!
l’ancien candidat libéral de Machin, ah! le «chum» du candidat libéral,
ah! lui était au bureau de Pierre Elliot Trudeau avant.
Là, au Point c’est le fils de Gérard Pelletier qui est là, alors de
quoi ça va te parler le Point ? Ça va
parler de rien… »
« Des fois je pourrais être jaloux, mais c’est
pas de la jalousie. Tu te dis qu’à
tous les mois il y a un «’tit clin» qui sort un film : Hochelaga,
Machin et tout ça. Ils l’interviewent : oui monsieur votre film… Je
dis : moi, vous m’avez jamais invité quand j’ai fait Octobre, quand
j’ai fait Gratton vous m’avez pas invité, quand je vais faire les Patriotes
vous n’allez pas m’inviter. Ils le
savent aussi parce que je ch… sur eux-autres… »
« Une affaire comme le Conseil des Arts du Canada,
ça contrôle toute la pensée. Ça donne
des bourses à des professeurs, à des gens qui font de la recherche
universitaire. Les professeurs savent
donc quoi chercher puis quoi ne pas chercher… »
« Vous cherchez sur tout, sauf sur ce que vous
devriez chercher… Je vais te donner des exemples dans d’autres sociétés :
moi j’suis un anthropologue, dans ma jeunesse on m’envoie travailler en
Martinique. La Martinique est une colonie
française déguisée en département :
la majorité noire, des descendants d’esclaves, encore «runné» par
des Blancs français. Tu regardes les travaux de recherche des anthropologues qui sont
allés là : ils ont étudié les proverbes martiniquais, la poterie, la pêche,
le tissage. Il y a mille études, pis
tabarnak, il y a une sur le racisme. Mais
tu te dis ici, c’est l’affaire fondamentale : l’exploitation…y’a
pas un tabarnak qui a travaillé là-dessus, ma gang de câlisse !… »
« Puis ce qui n’est pas contrôlé directement par
l’État, c’est contrôlé par ceux qui possèdent l’État… »
« La Loi des mesures de guerre, la même loi qui était
utilisée ici et contre les militants de l’ANC en Afrique du Sud, c’est la même
loi. Pourquoi ? C’est les mêmes crottés
qu’ici, c’est les Britanniques. Ils
nous fourrent icitte comme ils ont fourré les Africains, comme y ont fourré
les Asiatiques. Des fois les Québécois
ont l’impression d’être tout seul sur la terre… On a été colonisé par
les Anglais, ils ont fait la même chose qu’y ont fait en Palestine, aux
Indes, au Kenya, c’est les mêmes… ».
« Le rôle de l’intellectuel dans son propre peuple
c’est d’essayer d’amener au monde ce qu’on leur cache… »
Pourquoi
avoir choisi le Chevalier De Lorimier comme plaque tournante de votre
film 15 FÉVRIER 1839? En quoi est-il plus représentatif que d’autres
Patriotes?
« Il n’est pas plus représentatif… moi je fais des
films au Québec, donc on est un pays pauvre. Quand tu fais une vue y’a pas
beaucoup d’argent. Donc, tu vas faire
un film à deux ou trois millions. Si
j’avais fait un film à cent millions, j’aurais fait les batailles,
j’aurais fait autre chose. Là, tu fais
un film pas d’argent, comment j’peux aborder ça sans que cela coûte cher :
je vais essayer de raconter les Patriotes en passant par l’histoire du dernier
24 heures d’un gars qui va être pendu. C’est
le biais par lequel t’es obligé d’aborder ça.
Michel Brault a fait son film sur les Patriotes; il a fait ce que je ne
voulais pas faire. Il s’est dit : on va montrer les batailles, mais comme
t’as pas d’argent, au lieu de montrer dix mille gars au camp Baker à
Ste-Martine, tu fais un film où il y a trois Patriotes avec des «tits guns»,
«des tites» balles, pis là en face, il y a deux Anglais, peut-être quatre.
Donc, t’essaies de faire semblant, ça fait un film où on a l’air des «tits
clins». Les Québécois font des «tites»
affaires, une escarmouche où ils en ont tué juste 300…»
« Il y a eu 10 000 morts, mais il faut que tu
trouves une façon pas cher de
faire ça… T’essaies de transmettre le plus d’informations que tu peux sur
ce qu’était la révolte des Patriotes. Mon
film ne solutionne pas tous les problèmes…»
« C’est ce qui est intéressant avec
le cinéma ou l’art : tu frappes le spectateur.
C’est ça mon but des fois, frapper le monde pour les ébranler pis après
tu leur dis : Il y a des livres à la
bibliothèque, lisez… Le but de
mon film c’est d’abord de toucher le monde... De les réveiller, que les
jeunes et les vieux fassent du chemin par après.
Le film peut pas faire toute la «job»… C’est ma petite contribution
d’intellectuel québécois à la vie des idées dans
ce pays. La vie des idées ici
influence la vie des idées du reste de l’humanité.
Quand je fais un film sur des
patriotes ici, c’est un film universel parce qu’ailleurs aussi il y a du
monde qui sont morts pour la liberté…»
Certains établissements scolaires, dont l’UdeM, ont
signé des contrats d’exclusivité avec des entreprises.
Dans quel but croyez-vous que les
entreprises bombardent les étudiants
d’autant de publicités?
« Parce qu’ils sont de grands philanthropes, c’est
pour aider les jeunes à s’éduquer, parce qu‘ils aiment beaucoup la
jeunesse. Ils veulent absolument vous
encourager à devenir des citoyens exemplaires. Je
regarde l’«hostie» de publicité de
l’UdeM de mon cul avec Mulroney, avec toute la saloperie.
J’ai étudié là, ils
n’auront pas 5 cents! Comment ça une
place de haut savoir est capable de se brancher sur l’industrie?
Déjà que ce n’est pas fort ce que vous étudiez, mais ça va être
l’histoire de Wal-Mart, l’histoire de Bombardier. Déjà, l’Université vit
des compagnies publicitaires, elle vit et enseigne ce que la «business» a
besoin. Il reste quelques intellectuels
un peu responsables en histoire, en sociologie, en littérature, ce n’est pas
tous des trous de cul. Il ne faut pas que
la pensée soit soumise au gouvernement ou au «business».
Si j’étais étudiant, on t’arracherait ça [les pubs]…
C’est la seule réaction intelligente… »
« Les H.E.C., ce n’est pas fait pour aider le monde.
Même les facultés de sciences humaines vont se mettre à marcher droit.
Est-ce que ça
pourrait aller jusqu’à l’élimination de ces facultés?
Oui, ou ils vont garder les sociologues pour aider les
publicistes. J’haïs tellement la pub,
mettre de la pub quand tu pisses… »
Sommes-nous
une société américanisée et, si oui, dans quelle mesure le sommes-nous?
« J’ai étudié l’anthropologie, donc j’ai étudié
plusieurs peuples sur la terre. Je ne
fais pas de morale, tu regardes toutes les cultures sur la terre, chaque société
avait son costume, ses maisons, son architecture, son art, ses histoires, sa façon
de se marier, sa façon d’aimer. Qu’elle soit bonne ou pas, je m’en fous.
Mais là tout le monde est habillé pareil, tout le monde a la même câlisse
de casquette de base-ball, tout le monde a les mêmes «runnings», tout le
monde a les mêmes jeans, tout le monde mange la même cochonnerie, tout le
monde a les mêmes «hostie» de maisons, tout le monde regarde les mêmes
histoires. Aujourd’hui, les sociétés
sont toutes élevées par Mickey Mouse… »
« Je fais des films pour d’autres genres de héros que
les héros américains. Les héros américains
ont jamais peur, alors que ce n’est pas ça la vie. Dans la vie ça existe la
peur….»
Quelles sont vos plus grandes influences dans l’ensemble
de l’ensemble votre œuvre et pourquoi ?
«…les cinéastes québécois qui sont venus avant moi.
Entres autres deux gars, Pierre Perreault et Gilles Groulx,
deux très grands cinéastes de façon
ben différente. S’il y avait des histoires du cinéma un peu sérieuses, ces
hommes-là seraient en très bonne place. Le
peuple québécois, c’est pas un gros peuple, c’est pas une grosse culture
à côté de la culture américaine, la culture française.
Donc, souvent c’est eux-autres qui écrivent les histoires du cinéma.
Nous autres, on existe pas. Gilles
Groulx est dans quelques dictionnaires français. Moi, c’est eux autres qui
m’ont formé, c’est-à-dire qui m’ont réveillé dans la vie, la première
fois que j’ai vu des documentaires québécois.
J’ai toujours pensé quand j’étais jeune que le cinéma c’était
aussi niaiseux qu’aujourd’hui, des films avec Elvis Presley, les films avec
John Wayne, aujourd’hui c’est avec DiCaprio.
Eux-autres (Groulx et Perrault) ont fait des films où j’ai vu pour la
première fois du monde, le monde autour de chez nous.
Je me suis dit : «Câlisse, avec une caméra on peut montrer le
monde autour de chez nous.» C’est là
que j’ai commencé à vouloir faire du cinéma. Faire du cinéma, c’est pas
juste faire des niaiseries, on peut parler de nous-mêmes…»
« Dans mon œuvre, il y a Gilles Groulx et tout ça, pis
il y a d’autres affaires plus fondamentales sans doute.
C’est quand j’ai commencé à m’impliquer dans la lutte pour
l’indépendance; c’est la base de mon cœur et de ma pensée, la
lutte pour l’indépendance. Moi, j’avais 15 ans, j’ai embarqué là-dedans,
je trouvais ça ben trippant, pis en découvrant l’oppression ici….»
Croyez-vous
à la mise en péril de la culture québécoise considérant que la jeunesse
s’ouvre de plus en plus sur le monde, grâce entre autres aux médias ?
« Pour moi, est pas ouverte sur le monde, elle est
pauvre. Je ne sais pas sur quoi vous êtes
branchés. Si je regarde les journaux,
bon c’est peut-être pas des ben jeunes. Si je regarde le VOIR
par exemple, c’est pas ouvert, ça se dit ouvert sur le monde, c’est ouvert
sur New York, Paris, Londres… Prends un
gars comme Martineau. Lui il doit trouver
le Québec tellement petit et sans intérêt. Chaque
fois qu’il cite des auteurs, c’est toujours des auteurs américains,
toujours, quelques fois des auteurs français…»
« Je regarde mon petit gars par exemple qui écoute… je
sais pas comment ça s’appelle, du Rob Zombie, du métal, c’est tout américain,
c’est des groupes québécois comme Grim Skunk qui sonnent comme
l’autre de New York. Il regarde juste
des films américains, il est ouvert sur rien. Ouvert
sur le monde, sur le monde «my ass!»… »
« J’ai travaillé avec les jeunes de la Course autour
du monde à l’ONF, donc la génération de cinéastes après nous-autres.
Ils ont été formés à la course. Je
me suis aperçu qu’ils connaissent rien d’ici.
Sont allés au Congo, mais sont jamais allés sur la Côte-Nord; ils sont
allés au Tibet, mais ne sont jamais allés à Matane.
La génération qui était avant moi, ils ont commencé par découvrir ce
qui avait autour d’eux-autres. Les gens
se pensent s’ouvrir sur le monde, mais ne font que du tourisme de consommation
culturelle…»
Qu’est
ce que le nationalisme selon Pierre Falardeau ?
« Des fois, il y a des problèmes dans le langage où on
ne définit pas toujours un mot qui a une signification à une place, une autre
signification ailleurs. J’ai jamais fouillé sur la signification du mot «nationalisme»;
je sais que quand j’étais jeune, j’ai découvert la pensée nationaliste au
Québec, ça m’a embarqué. Quand
j’ai été en France pis que j’ai employé le mot nationalisme, là ça
avait un sens péjoratif que moi ça avait jamais eu dans mon langage.
Maintenant, c’est en train de se produire ici aussi, le mot
nationalisme, ça devient suspect…»
« Dans la résistance, sous l’occupation nazie, le
Front national était un mouvement d’extrême gauche, c’était la gauche
française qui était nationaliste. La
gauche française défendait la nation parce la nation était occupée. Alors
moi, je suis un nationaliste québécois, moi je défends la nation québécoise
qui est une nation occupée et annexée. Ceux
qui trouvent ça sale, qui viennent me le dire, m’a leur casser la gueule…
Parce que moi je ne me sens pas impur, sale, méprisant envers qui que ce
soit. Si le nationalisme c’est pas bon
pour les Québécois, ça devrait pas être bon pour les Canadiens non plus.
Il y a le nationalisme des
petits peuples, il y a aussi le nationalisme impérialiste.
Quand je vois des Américains avec leur drapeau, pis après tu vois des
Palestiniens qui se promènent avec leur drapeau, ça n’a pas la même
signification. Le peuple palestinien défend
son existence, sa vie, son droit à un État… »
« Si j’étais américain, je ne serais pas
nationaliste. Je suis nationaliste parce
notre peuple est menacé… »
Quelle
place faites-vous à la démocratie dans votre conception du nationalisme québécois
?
« Le mouvement national au Québec a décidé de mener
une lutte démocratique. Il y a eu le
F.L.Q., qui était une lutte armée, alors que le mouvement national du PQ a décidé
qu’il ferait ça de façon démocratique. Mais
d’autre part, je ne me fais pas trop d’illusions sur la démocratie.
On es-tu vraiment dans un système démocratique?
Quand toute la presse est asservie à la même «gang».
Quand René Lévesque a amené une loi aussi insignifiante que la loi des
financement des partis, chaque parti n’avait pas le droit de se faire financer
par des grandes compagnies, c’est plus démocratique que la loi canadienne.
Le parti Libéral, ça reçoit de l’argent des banques, des grandes
compagnies; au Québec ils n’ont pas le droit.
Donc, on est plus démocratique que de l’autre bord. Quand on nous
propose de faire un référendum, c’est démocratique; quand Chrétien dit :
« On le reconnaîtra pas»… Ce
n’est plus 50% plus un, ça va être
plus… Ça, c’est antidémocratique. Partout sur la terre, la loi de tout ce
qui est démocratique c’est 50 % plus un, partout. Pis là il y a des «hostie»
de trous de cul qui ont marché là-dedans tout le temps qui gagnaient, à 60/40
pis y disent : «on a gagné!». Ils
disent au dernier (référendum) :
«On a gagné!» Ah oui, par moins de un pour cent ?… »
Comme nous pouvons le constater, rien
ni personne ne peut freiner l’ardeur de ce militant qui demeure, somme toute,
un intellectuel honnête envers lui-même et ses convictions nationalistes.
Puisant une force de persévérance de ces mêmes convictions, Falardeau,
qu’il soit admiré ou décrié, ne laisse personne indifférent.
Les débats qu’il suscite sont à l’image du créateur et permettent,
en fin de compte, à Falardeau de revendiquer sa place parmi les contestataires
de l’ordre établi. Il
reste encore quelques mois avant la sortie de son nouveau film qui, selon
Falardeau lui-même, pourrait être son dernier… Une histoire à suivre.
« 15 FÉVRIER 1839 » de
Pierre Falardeau, EN SALLES FÉVRIER 2001
Haut de la page
Index - Entrevues